
Port-au-Prince n’est plus seulement une ville, c’est un cimetière en mouvement, un théâtre où l’insécurité joue le premier rôle. Dans cette fresque de balles, de sang et de cendres, le quotidien se meurt, et l’espoir vacille sous le poids d’une organisation méthodique du chaos. Cette prose poétique est un cri, un miroir tendu à une réalité insoutenable, où chaque souffle est une résistance, et chaque silence, une trahison. Que le monde regarde, écoute, et enfin pleure avec Haïti.
Port-au-Prince saigne…
Non, elle ne pleure pas, elle saigne, goutte à goutte, un sang noir mêlé de cendres et de feu. Dans ses artères défoncées, les balles sifflent comme des hymnes de guerre, orchestrées par des doigts maigres d’enfants soldats. Ils ne jouent pas à la guerre, ils la vivent, bras tendus, mâchoires serrées, leurs ombres déchiquetées par le crépitement des armes.
La ville est un brasier. Les maisons brûlent sans crépitements, avalées par des incendies sans fin. Les ruelles sont des pièges, chaque coin de rue, un labyrinthe où rôdent les gangs, maîtres des ténèbres. Ils kidnappent la lumière, ils kidnappent les corps, ils kidnappent l’espoir. Les femmes comptent leurs enfants comme on compte les jours d’un calendrier maudit : en espérant qu’il en reste un demain.
Haïti est un théâtre où les acteurs jouent leur propre mort. Une tragédie sociale, écrite avec les larmes des mères et l’innocence volée des enfants. Le sang ne coule plus dans les veines du pays, il s’écoule dans ses rues. Chaque jour est une scène, chaque nuit un acte de désespoir. Ici, on ne vit pas : on survit.

Les politiciens rient derrière leurs vitres teintées, assis sur des trônes bâtis avec des mensonges et des enveloppes brunes bourrées de dollars sales. Leur corruption suinte des murs des palais, une sueur froide qui poisse jusqu’aux marches où les pauvres tendent leurs mains vides. À chaque mot qu’ils prononcent, une vie s’éteint quelque part dans les bidonvilles. Mais ils ne prononcent pas des mots, ils crachent des promesses comme on crache du venin.
Et la Police ? Une blague amère. Une tragédie masquée d’uniformes trop grands pour eux. Ils avancent comme des ombres sous-payées, des cibles ambulantes dans une guerre qu’ils ont déjà perdue avant même de la commencer. Ils tirent parfois, mais c’est toujours trop tard, toujours dans le vide, toujours pour rien.
Haïti est devenu un paradoxe vivant : un pays qui se meurt debout, un peuple qui refuse de tomber mais qui s’effondre à l’intérieur. L’âme est meurtrie, le corps épuisé, mais le rire, ce rire cynique et cruel, survit. Parce qu’ici, on ne peut pas se permettre le luxe de pleurer chaque mort. Les larmes coûtent trop cher, et la douleur est gratuite.

Dans les entrailles de Port-au-Prince, les meurtres sont devenus un refrain. On ne les compte plus, on les traverse comme on traverse une saison. Chaque assassinat, une virgule dans un récit sans fin. Chaque rafale, une page tournée. Ici, les morts ne reposent pas en paix : ils flottent dans l’air, collent aux murs, hantent les ruelles avec des hurlements qu’on n’entend même plus.
Et pourtant, Haïti rit. Un rire féroce, un rire acide, un rire qui dévore. Parce qu’ici, pleurer ne suffit pas. Parce qu’ici, le rire est une arme contre l’insupportable. Les gens rient devant les braises de leur maison, rient devant les silhouettes armées qui errent dans la nuit, rient même quand leurs enfants apprennent à compter en dénombrant les éclats de balles.
Le silence du monde est pire que la violence des armes. Chaque balle tirée, chaque vie volée est un écho qui se perd dans une indifférence glaciale. La tragédie d’Haïti n’est pas qu’elle souffre, c’est qu’elle souffre seule, sous le regard détourné de ceux qui pourraient tendre une main.
Port-au-Prince est un cimetière en mouvement. Les pavés rouges racontent des histoires que personne n’a envie d’entendre. Les toits s’effondrent, les murs s’écroulent, mais quelque part, une voix persiste. Une voix qui grimace, qui hurle, qui refuse de mourir. Une voix qui rappelle que, même dans la cendre, il reste des braises. Que, même au cœur du chaos, un cri peut encore faire trembler l’univers.

Et pourtant, Haïti a le courage de résister à la mort. Ce pays, ce peuple, est une flamme qui refuse de s’éteindre, une cicatrice qui témoigne d’un combat incessant contre l’oubli. Haïti pleure en silence, mais ses larmes sont des poèmes gravés dans la pierre, des appels à l’humanité tout entière : regardez-nous, écoutez-nous, pleurez avec nous.
Si la terre pouvait pleurer, elle le ferait pour Haïti. Pour chaque enfant qui devient soldat avant d’être adulte. Pour chaque mère qui serre contre elle une photo fanée, seul souvenir d’un fils disparu. Pour chaque père qui ne sait plus s’il prie pour un miracle ou pour un repos sans douleur. Si la terre pouvait pleurer, ses larmes formeraient des rivières qui emporteraient les balles, les armes, le feu, et laisseraient derrière elles des graines d’espoir. Mais la terre ne pleure pas. Alors Haïti continue, seul, debout dans les flammes, à hurler à un monde qui ne veut pas l’entendre.
Et Port-au-Prince, immobile en apparence, bouge pourtant sous le poids de ses fantômes. Chaque rue, chaque maison, chaque souffle porte la marque d’une insécurité méticuleusement tissée, comme une toile d’araignée où tout le monde est pris au piège. Rien n’y est laissé au hasard : des balles qui trouvent toujours leur cible, des enlèvements planifiés comme des affaires lucratives, des vies troquées contre des rançons qui engraissent un système déjà pourri.
Ce cimetière en mouvement n’est pas l’œuvre du hasard, mais d’une mécanique implacable où la peur est l’unique monnaie. Haïti ne meurt pas d’un coup, il se désagrège, morceau par morceau, dans une danse funèbre orchestrée par ceux qui prospèrent dans ses cendres.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

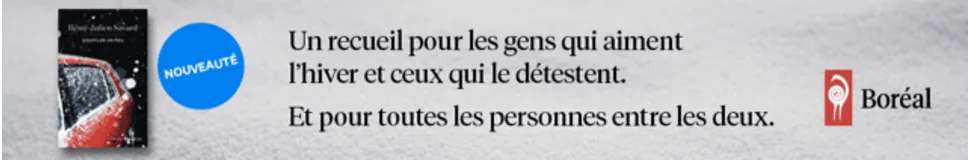




One thought on “Port-au-Prince est un cimetière en mouvement”