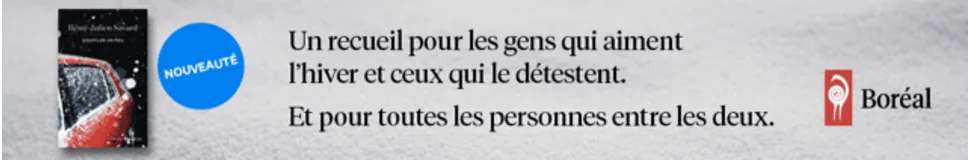Le Canada, pays vaste aux forêts généreuses, aux hivers interminables et aux slogans accueillants, aime à se voir comme un phare de la démocratie, un bastion de l’hospitalité.
Il n’est pas rare d’y entendre des discours empreints de grandeur morale sur la solidarité internationale, les droits humains, ou encore la protection des plus vulnérables.
Pourtant, il suffit de gratter un peu la surface pour découvrir une vérité plus contrastée. Car derrière l’image de la terre promise se cache parfois un système migratoire sélectif, complexe, et de plus en plus restrictif.
Le dépôt du projet de loi fédéral C-2, intitulé pudiquement « Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière », vient jeter un froid sur cette image reluisante. Si l’objectif déclaré est de lutter contre les menaces transnationales comme le trafic de drogues ou la criminalité organisée, le texte va bien au-delà de ce mandat.
Il propose une refonte partielle mais significative du droit d’asile et confère des pouvoirs étendus à l’exécutif en matière d’immigration. Une réforme qui soulève de sérieuses inquiétudes sur le respect des principes juridiques fondamentaux et des engagements internationaux du Canada.
L’asile, cet invité indésirable
Il faut d’abord s’attarder sur ce qui semble être la pierre angulaire de cette réforme : la limitation du droit d’asile. Deux nouvelles règles d’irrecevabilité sont introduites. D’une part, une personne ne pourrait plus demander l’asile si elle est entrée au Canada depuis plus d’un an, même si sa situation a radicalement changé entre-temps. D’autre part, l’accès à l’asile serait également refusé à ceux et celles qui arrivent par les États-Unis, pourtant souvent considérés comme une première étape de l’exil.
L’argument avancé par le gouvernement est simple : protéger l’intégrité du système, éviter les abus, et garantir une gestion plus fluide des dossiers. Pourtant, à y regarder de plus près, cette rhétorique d’efficacité administrative masque mal un glissement vers une logique dissuasive, où le soupçon prend le pas sur la présomption de bonne foi.
Car les trajectoires migratoires ne sont pas toujours linéaires ni planifiées avec rigueur. Un demandeur peut fuir dans l’urgence, vivre un temps sans demander l’asile par méconnaissance ou crainte, puis décider de le faire lorsqu’il se sent en sécurité ou découvre ses droits. Le priver de ce recours sous prétexte qu’il a attendu trop longtemps, c’est ignorer les réalités humaines et les bouleversements politiques soudains qui peuvent transformer un séjour temporaire en fuite irréversible.
Un autre élément du projet de loi consiste à abolir la fameuse « règle des quatorze jours » de l’Entente sur les tiers pays sûrs. Jusqu’alors, une personne entrée clandestinement au Canada par la frontière américaine pouvait, après deux semaines de présence, demander l’asile sans être renvoyée. Désormais, cette porte entrouverte se referme. On durcit les règles, on élimine les échappatoires, on renforce le blindage.
Ce durcissement semble s’inscrire dans une volonté plus large d’harmonisation avec les politiques de l’administration américaine. Or, le Canada a toujours revendiqué son autonomie éthique en matière de migration. En niant l’accès à l’asile aux personnes provenant des États-Unis, pays que plusieurs experts et organismes de défense des droits considèrent comme non fiable pour la protection des réfugiés, le Canada prend le risque de renvoyer des personnes vulnérables vers des pays où elles pourraient être exposées à des traitements inhumains ou à la persécution.
Cette évolution traduit un malaise : comment conjuguer souveraineté nationale et solidarité internationale? En refusant l’asile à ceux qui ont transité par les États-Unis, le pays semble céder à une pression diplomatique plutôt qu’à une véritable nécessité sécuritaire. L’équilibre entre fermeté frontalière et devoir humanitaire semble pencher dangereusement du côté de la répression.
Des procédures à deux vitesses
L’alternative proposée à l’asile classique est l’ERAR – l’examen des risques avant renvoi. Ce dispositif, bien que présenté comme un filet de sécurité, n’offre en réalité ni la même indépendance ni les mêmes garanties procédurales que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Une audience réduite, peu de temps pour rassembler les preuves, peu ou pas de droit d’appel… En somme, une procédure simplifiée, mais aussi appauvrie en droits.
Ce basculement vers un traitement administratif, plutôt que juridictionnel, du sort des migrants s’apparente à une déjudiciarisation d’un enjeu fondamentalement humain. Cela revient à dire : vous pouvez être entendus, mais pas vraiment. Et surtout, pas trop longtemps. L’urgence devient la norme. Et ce qui devrait être une protection devient une course contre la montre.
Dans ce contexte, le discours gouvernemental selon lequel le système demeure conforme aux engagements internationaux sonne un peu creux. Le respect formel des conventions ne garantit pas leur esprit. Ce n’est pas parce qu’un mécanisme minimal de protection subsiste que la dignité des personnes est respectée.
Au-delà du volet asile, le projet de loi prévoit des mesures qui élargissent considérablement les pouvoirs de l’exécutif. Il permettrait, par simple décret, d’annuler ou de modifier en bloc des documents d’immigration, de suspendre des traitements de dossiers, ou de partager des renseignements personnels entre ministères.
Un tel dispositif, justifié par « l’intérêt public », laisse planer une ombre sur l’État de droit. Car l’intérêt public, notion à géométrie variable, peut devenir un prétexte pour des décisions politiques ou stratégiques sans obligation de justification ni de transparence. Le risque d’arbitraire devient bien réel.
Il faut rappeler que la stabilité du statut migratoire est un fondement de l’intégration. Introduire l’incertitude permanente quant à la validité de ses documents, c’est condamner les personnes migrantes à vivre dans l’angoisse. Cela affaiblit la confiance envers les institutions et nourrit un climat de suspicion généralisée.
L’éthique migratoire à l’épreuve
Ce texte ne prétend ni diaboliser ni canoniser une politique. Il ne s’agit pas d’ignorer les défis bien réels liés à la gestion des frontières, à la sécurité publique ou à l’intégrité du système d’immigration. Mais il est fondamental de se poser la question suivante : à quel prix ?
Le projet de loi C-2, sous couvert de modernisation, opère une réorientation profonde du rapport entre le Canada et ceux et celles qui cherchent refuge. Il substitue à la logique d’accueil une logique de tri. Il remplace la présomption de vulnérabilité par une suspicion d’abus. Il supprime des passerelles au lieu d’en créer.
Ce virage, s’il se confirme, aura des conséquences durables sur l’image du Canada, mais surtout sur la vie concrète de milliers de personnes. Il transformera l’asile, non plus en droit accessible, mais en privilège conditionnel.
Au fond, ce n’est pas seulement une loi que l’on doit interroger, mais une époque. Une époque où les nations se ferment plus qu’elles ne s’ouvrent, où la migration est perçue moins comme un phénomène à comprendre que comme un problème à régler. Le Canada, dans ce contexte mondial, n’est ni meilleur ni pire que les autres. Mais il est en train de faire un choix.
Choisira-t-il de rester fidèle à l’image qu’il projette de lui-même ? Ou acceptera-t-il que, sous la pression de la peur, du voisinage politique ou de la complexité administrative, le droit d’asile soit relégué au rang de simple variable d’ajustement ?
« Bienvenue au Canada », dit la pancarte à la frontière. Mais en petit caractère, presque invisible, il faut désormais lire : « sauf si vous demandez l’asile ». C’est là que se joue une bataille silencieuse, mais décisive : celle de notre conception de la justice.
Car la justice, ce n’est pas d’offrir l’asile à ceux qui arrivent aux bons endroits, aux bons moments, avec les bons papiers. La justice, c’est de tendre la main à ceux et celles qui en ont besoin, même si c’est compliqué, même si c’est risqué, même si c’est dérangeant.
Et si l’on perd cela, alors il ne restera plus qu’un décor, un slogan, une illusion de générosité. Mais pas le geste. Pas la promesse. Pas le Canada qu’on croit être.
Ce que nous avons peut-être oublié de nous-mêmes
Mais il est une vérité que ni la gauche ni la droite ne peuvent nier, une vérité nue, sans fard, qui traverse les discours, les bulletins de vote et les bulletins météo : les gens fuient. Pas toujours parce qu’ils veulent. Mais parce qu’ils n’ont plus le choix. On ne quitte pas son pays par désinvolture. On ne déracine pas une existence pour venir l’offrir en pâture à une bureaucratie froide. On ne choisit pas de traverser les frontières comme on choisit un billet d’avion pour des vacances. Il y a dans chaque demande d’asile une histoire d’abandon, de perte, de silence ou de cri. Et il n’y a pas de logiciel gouvernemental capable de quantifier la détresse.
Alors, à ceux qui façonnent les lois, qui les défendent ou les contestent, il faut poser une question sans idéologie : quelle part d’humanité voulez-vous laisser dans le mécanisme ? À force de tout rendre administratif, chiffré, contrôlé, est-ce que nous ne risquons pas d’oublier que derrière chaque formulaire, il y a une voix ? Une odeur de pays natal, un visage d’enfant, une mère laissée derrière, un espoir de recommencer.
Peut-on prétendre sécuriser une frontière sans insécuriser des vies ? Peut-on défendre un territoire sans déserter l’éthique ? Peut-on bâtir un avenir commun en érigeant des murs invisibles qui nous protègent autant qu’ils nous isolent ?
Il ne s’agit pas ici d’ouvrir toutes grandes les portes, ni de les verrouiller toutes. Il s’agit de regarder les visages. De lire les récits. D’entendre la nuance.
Le droit d’asile n’est pas une faiblesse d’État. C’est une force morale. Une capacité rare : celle de faire place à l’inattendu, à l’étranger, à l’humain.
Et si demain, c’était vous, votre frère, ou votre enfant, fuyant, marchant dans la neige, un sac à l’épaule, des papiers incertains, un rêve incertain, un regard vers un poste frontalier éclairé, espérant qu’au-delà du mot « Bienvenue », il y ait un cœur qui bat ?
Alors, peut-être que ce n’est pas à la frontière qu’il faut poser les plus grandes barrières. C’est dans notre manière de voir. Car un pays ne se juge pas à la hauteur de ses clôtures, mais à la profondeur de sa compassion.
Et ce qui nous sauvera – en tant que citoyens, que nations, que collectifs humains – ce ne sera jamais la peur, ni la force, ni la rigueur administrative. Ce sera la capacité de reconnaître dans l’autre ce que nous avons peut-être oublié de nous-mêmes.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.