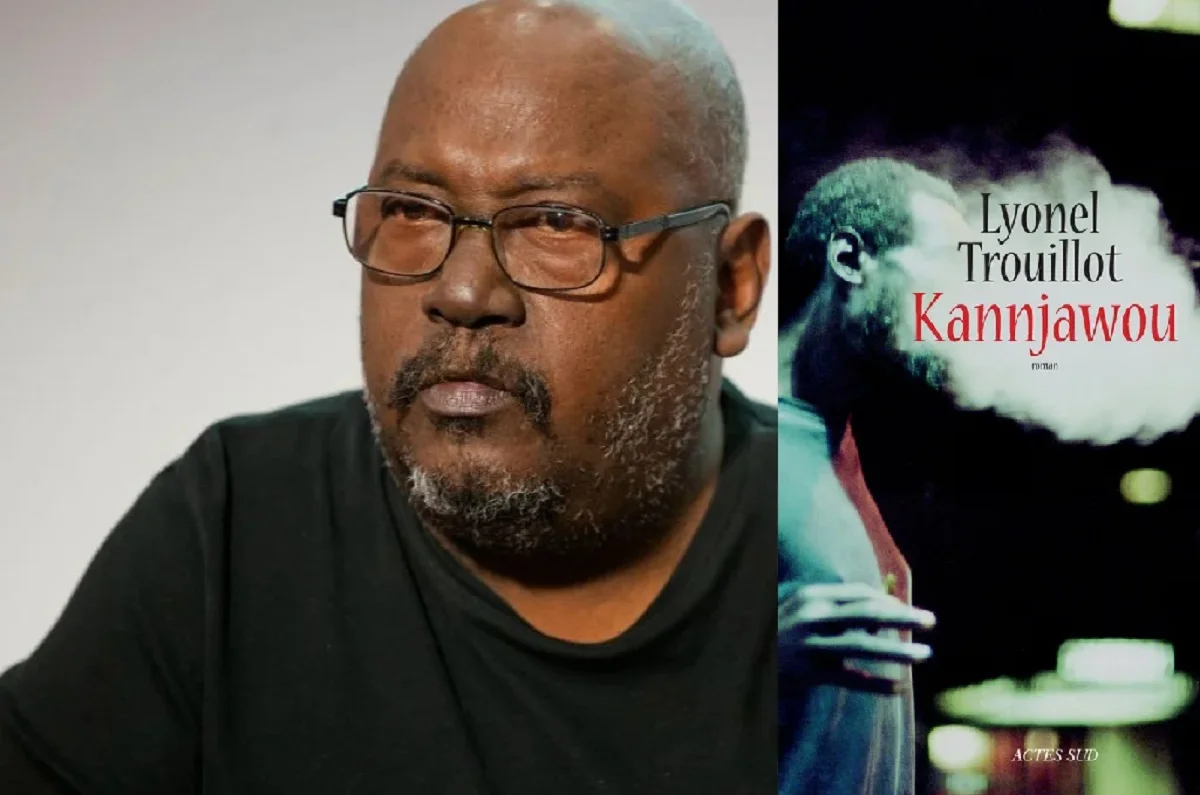Il faut avoir vu un feu de la Saint-Jean, un vrai, pour comprendre ce que c’est qu’un peuple qui s’appartient. Pas juste une foule avec des drapeaux bleus et blancs, non. Mais une communauté réunie autour d’un brasier, d’un chant, d’une fierté sourde et paisible, un peu comme la braise qui ne crie pas, mais qui chauffe tout le monde.
Je me souviens de ma première fête nationale au Québec comme d’un rendez-vous avec l’essentiel. C’était en 2011, dans un quartier populaire de Montréal.
J’étais encore un jeune immigrant, les yeux pleins de méfiance et le cœur partagé entre la joie d’avoir quitté l’absurde et la peur de ne jamais appartenir vraiment. J’étais allé par curiosité. J’en suis ressorti changé.
Ce soir-là, dans un petit parc municipal, les familles s’étaient installées sur des couvertures, des guitares circulaient, des bières aussi. Un homme, la cinquantaine rieuse, est venu me voir. Je ne le connaissais pas. Il m’a tendu un hot-dog et m’a dit :
« C’est pas un grand repas, mais c’est fête. Ce soir, t’es Québécois toi aussi. »
Il avait une barbe comme on n’en fait plus, un accent que je comprenais à peine, et cette capacité désarmante qu’ont certains Québécois de vous offrir une fraternité sans mode d’emploi. C’était simple. C’était grand.
De Jean le Baptiste à Jean le Québécois
La Saint-Jean, c’est d’abord une survivance. Une mémoire. Une manière pour un peuple de se rappeler que même si on ne domine pas l’histoire, on peut toujours l’habiter. On sait qu’elle fut d’abord religieuse : Jean le Baptiste, cousin du Christ, grand prédicateur dans le désert, patron des Canadiens français par décret papal. Mais la fête a migré. Elle a quitté les églises pour aller rejoindre les parcs, les scènes en plein air, les ruelles, les plages du fleuve et même les balcons des HLM.
En 1834, à Montréal, Ludger Duvernay — journaliste, imprimeur, patriote — organise un banquet pour « unir les Canadiens de toutes origines ». Ce jour-là, le 24 juin, devient une fête nationale officieuse. Un appel à la solidarité dans un Bas-Canada fracturé, inégal, colonial. Ce n’est pas anodin : l’idée de nation naît souvent dans les marges, dans les douleurs communes, dans le refus d’être effacé.
Plus tard, en 1925, on en fait un jour férié. Et enfin, en 1977, le gouvernement de René Lévesque lui donne son nom définitif : fête nationale du Québec. Ce n’est plus simplement la fête des francophones. C’est la fête de tous ceux qui font partie de ce territoire, qui ont choisi ou hérité cette terre pour vivre ensemble, dans ce projet fou qu’on appelle le Québec.
Ce qu’il y a de beau dans la Saint-Jean, c’est qu’elle n’a jamais été totalement institutionnelle. Même quand l’État s’en mêle, même avec les grands concerts télédiffusés et les discours, elle garde cette tendresse un peu sauvage des fêtes populaires. Elle résiste au lissage. Elle accepte les excès, les différences, les contradictions.
Et il y en a. Car être Québécois aujourd’hui, ce n’est plus — seulement — être catholique, blanc, descendant des pionniers du Saint-Laurent. Être Québécois, c’est porter un accent, parfois plusieurs. C’est conjuguer son identité à plusieurs temps. C’est aimer la poutine autant que le riz collé. C’est danser sur du Gilles Vigneault mais aussi sur du Loud, du Koriass, ou du Fredz. C’est parler français, le défendre, l’aimer — même quand il nous fait mal. C’est comprendre que le nous s’élargit, non pour se dissoudre, mais pour se renforcer.
Il n’y a pas de pays parfait. Il n’y a que des pays qui essaient. Le Québec est de ceux-là. Il tente. Il tâtonne. Il trébuche, parfois, dans ses débats sur l’identité, l’immigration, la langue. Mais il se relève. Toujours. Et la Saint-Jean, chaque année, nous le rappelle.
Une fierté tranquille, pas passive
Revenons à ce feu, ce fameux feu de la Saint-Jean. Il est à la fois réel et symbolique. Réel, parce qu’il chauffe. Symbolique, parce qu’il rassemble. Autour du feu, il n’y a plus de statut, plus de hiérarchie. Il y a des voix qui chantent faux mais avec cœur, des enfants qui dansent comme des lutins, des aînés qui racontent leur première Saint-Jean dans un champ, en 1950, avec de la musique à bouche et un violon grinçant.
Ce feu m’a parlé. Il m’a dit que le Québec est une promesse. Une promesse de dignité, de langue vivante, de solidarité. Une promesse qu’on ne tiendra peut-être jamais entièrement, mais qu’on continue de faire. Et c’est cette tentative qui fait la grandeur du lieu.
Je me souviens, ce soir-là, d’un homme qui s’est mis à réciter du Gaston Miron. Il avait bu, c’est vrai. Mais ses mots avaient plus de lucidité que bien des éditoriaux. Il disait :
« Je te prendrai marcheur d’un pays d’haleine
à bout de misères et à bout de démesures
je veux te faire aimer la vie notre vie
t’aimer fou de racines à feuilles et grave
de jour en jour à travers nuits et gués
de moellons nos vertus silencieuses »
Et quelqu’un a applaudi. Puis un autre. Puis tout le monde.
Ce n’était pas organisé. Ce n’était pas prévu. C’était beau. C’était ça, être ici. On dit souvent que les Québécois ont une fierté tranquille. C’est vrai. Mais tranquille ne veut pas dire molle. C’est une fierté patiente, enracinée, qui ne cherche pas à écraser l’autre mais à tenir debout. C’est une fierté qui fait l’humour sa première défense, la musique sa langue d’accueil, la neige sa philosophie de vie.
Et pourtant, cette fierté sait se lever. Elle l’a fait en 1960, pendant la Révolution tranquille. Elle l’a fait en 1980 et en 1995. Elle le fait aujourd’hui, autrement. Elle le fait quand elle exige le respect de sa langue. Quand elle accueille les nouveaux arrivants sans leur demander d’oublier leur passé. Quand elle doute, aussi. Car douter, c’est ne pas s’installer dans le confort des certitudes.
La Saint-Jean, c’est aussi la fête de ceux qui aiment le Québec
Ceux qui l’aiment avec des nuances. Ceux qui ne comprennent pas encore tout, mais qui s’appliquent à écouter. Ceux qui parlent français avec un accent d’Haïti, d’Algérie, de Belgique ou de Saguenay. Ceux qui posent des questions. Ceux qui défendent le Québec sans jamais l’idéaliser.
Et peut-être que la plus belle manière d’être Québécois, c’est d’aimer ce pays comme on aime une personne imparfaite : pour ses défauts, ses tics, ses manières, sa voix rauque au réveil, son génie en cuisine, sa patience à l’hiver et sa folie douce en été.
Je ne suis pas né ici. Mais le feu de la Saint-Jean m’a adopté.
Je ne connais pas tous les couplets du Gens du pays, mais j’en murmure assez pour comprendre l’émotion dans les yeux de ceux qui les chantent.
« Le temps que l’on prend pour se dire: je t’aime
C’est le seul qui reste au bout de nos jours
Les voeux que l’on fait les fleurs que l’on seme
Chacun les récolte en soi-même
Aux beaux jardin du temps qui courtGens du pays c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour
Gens du pays c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour »
Je ne suis pas un pur laine. Mais je tisse chaque jour un peu de cette laine dans ma propre histoire.
Et chaque 24 juin, je me souviens de cet homme au hot-dog et à la tendresse désinvolte. Il ne savait pas qu’il me donnait bien plus qu’un repas.
Il me donnait une place autour du feu.
Bonne fête nationale, Québec.
Longue vie à ton feu, à ta langue, et à ta façon unique de faire de la fête un acte de mémoire.