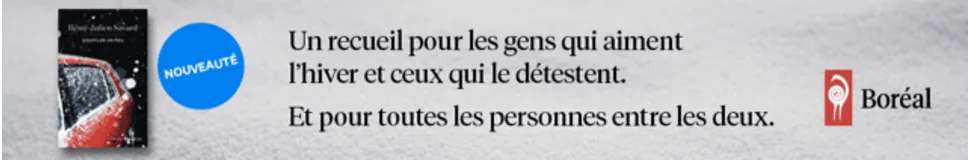Il arrive que certains lieux, en tombant, dévoilent ce que nous refusions de voir debout. La disparition de l’Hôtel Oloffson n’est pas qu’un fait divers architectural ou un simple incendie de plus dans un pays qui chancelle. C’est un symptôme. Le symptôme d’une époque où la mémoire s’efface plus vite que les braises ne refroidissent, où brûler devient une forme d’expression plus éloquente que construire. Ce n’est pas seulement une maison qui s’effondre : c’est une archive vivante, un théâtre du réel, un espace où s’écrivait à bas bruit l’histoire d’un pays complexe, qui se consume sans que l’on sache encore si c’est par indifférence, vengeance ou abandon.
On brûlait des maisons tous les jours. On ne les questionnait pas comme lieux de mémoire ou de ce qu’elles avaient cessé d’être comme on le fait pour l’Hôtel Oloffson. Mais elles l’étaient toutes pourtant dans les deux sens — parfois — pour une famille contre une autre, une personne contre une autre, un silence ou pire pour un pays (dans le mauvais sens ou dans le bon). L’histoire de l’Hôtel Oloffson comme bien et patrimoine familial dit l’histoire d’Haïti et de ses ambivalences quant à la reproduction sociale.
Quand on pense à ce bâtiment et qu’on connaît son origine, l’histoire des reproductions des classes sociales en Haïti, on se dit, peut-être, qu’il est un lieu vivant ou de telle famille matérialisée dans tel roman de Justin Lhérisson. Ce qu’on peut être en Haïti quand on est de couleur, quand on est blanc. Avec qui on peut s’asseoir, qui on peut recevoir même quand pour toute éducation, on a fréquenté une école publique dans un zip code négligé à New York ou pour toute fortune, on avait un compte épargne de trente dollars et quelques centimes avant de rentrer à Port-au-Prince et d’y élire domicile.
L’Hôtel Oloffson tient pour image ou du moins les restes d’une image : comment la fortune peut être distribuée, gardée et disparue. Des querelles de fils légitimes. Mariage. Le colorisme. Brûler un lieu comme celui-ci, ce n’était pas seulement une atteinte à une propriété dite un lieu déjà mort : c’est un attentat (on aurait pu le détester), contre un espace de représentation (on pouvait ne pas partager son contenu), contre un lieu de mémoire (qu’on n’aurait peut-être pas choisi de prendre pour référence), contre l’archive vivante d’un pays qui, malgré tout, conservait encore quelques récits debout. Brûler des maisons privées, c’est une déclaration de guerre à la dépossession, qu’on vit tous les jours à différentes échelles.
Kay bò lanmè, petite échelle. Hôtel, grande échelle. Tout est là. Mais cela dit aussi une défaite. Non pas dans la banalisation du feu, (mais de la dépossession), dans la systématisation de la déconstruction. Ce n’était pas un élan incontrôlé. C’était une stratégie criminelle. Méthodique. Répétée. Ciblée. “Boule pwopriyete, kit nan Site Solèy, kit se otèl, se zafè Lakou penal.” Ce n’était pas un accident. C’était une signature. Et cette signature doit être lue dans toute sa gravité.

Si le mal vient de la maison d’à côté, d’un voisin que je déteste parce qu’il a participé comme lieu d’hébergement d’un mal qui précède, est-ce bien le moment de questionner le sens de sa vie passée, de sa présence ? Est-ce encore le temps de la nuance, quand les symboles partent en cendres ? Quand on assiste à la dépossession de tout un pays ? La lucidité suffit-elle quand le réel nous consume ? Dirait-on à un homme combien il avait été mauvais en le regardant dans le cercueil ? Ne faut-il pas toujours un peu de décence, encore plus face à la mort ?
On n’avait pas à le demander, peut-être, pour Hitler. On peut questionner la valorisation de Richelieu, la mémoire de Charles X, ou l’affreux Napoléon ou Duvalier de la même manière aujourd’hui. Demain, Netanyahou, les Clinton, Trump, si la mort les touche demain, on ne se cachera pas pour dire, c’est pour le bien et la paix de nos voisins. Ce n’est pas la mort de tout homme qui doit diminuer l’homme.
Mais la mémoire de l’Oloffson — qu’elle fût architecturale, culturelle, affective — diminue un peu… elle n’appartient pas à “hier”. Sa destruction dit et appelle à quelque chose, à une vigilance, peut-être. L’Oloffson aurait dû être une mise en garde contre. Une conscience. Un repère pour ne pas faire comme. Une borne pour éviter à d’autres places de servir le réel de la même manière, contre les penseurs de l’origine du mal. Mais on l’a raté. Même pas tenté. Si les jeunes générations de moins de 30 ans n’étaient pas au courant de ce que le lieu avait été, ou tournaient le dos à cette mémoire, ce n’était pas la faute du lieu… En toute considération, il faut reconnaître que l’Oloffson fut, à bien des égards, un bastion pour une communauté. Sans cet hôtel — ou sans ce qu’il a permis d’abriter — peut-être que la lutte pour les droits des personnes LGBTQ en Haïti n’aurait jamais trouvé un tel lieu de résonance, ni même de commencement. Ce lieu fut à la fois refuge, scène, et levier. Il incarna, au fil des décennies, un espace de résistance, de visibilité et de mise en mots de ce qui, ailleurs, restait tue. Mais c’est aussi — et peut-être surtout — le combat d’une génération pour qui les enjeux de genre, de sexualité et d’appartenance ne se déploient plus sur les marges, mais au cœur du tissu social et politique.
C’était nous qui avions cessé de le faire parler, de nommer ce qu’il avait été, de le faire lire dans le présent. Et ce que nous brûlions aujourd’hui, ce n’étaient pas seulement des murs morts. Mais ceux qui disent les complicités et la désolation. Le lieu n’était pas mort. Il était juste abandonné car le plan des spécialistes de l’aide humanitaire a fonctionné. Autrement, pourquoi s’acharner contre les morts, si vraiment ils le sont ? On ne peut se passer de son sens, autant que des raisons de son absence. Aujourd’hui, il faut juste continuer à nommer le crime, les coupables, l’urgence.
Il ne s’agit pas non plus ici de céder à l’émotion, encore moins à cet apitoiement des humanitaires qui transforment cette fumée en compassion. On n’y est plus, nous, Haïtiens. Nous sommes dans la défaite. La défaite du quotidien. La défaite du pouvoir de rêver, de planifier et d’imaginer. On y est comme empêchement et l’Oloffson est aujourd’hui ce qui le dit encore plus. Le lieu : ce qu’il avait été. Ce qu’il avait contenu. Ce qu’il avait vu. Ce qu’il avait permis — et, plus souvent encore, empêché. On pouvait le critiquer. On pouvait détester ce qu’il avait fait de la culture. Les mauvaises gens qu’il avait nourris, fait rire, fait danser. Mais disparu, on peut aussi crier.
Cela ne nous rendra ni moins lucides, ni moins engagés. Crier, non pas pleurer comme font les Blancs — les anciens spécialistes de l’aide humanitaire, les chercheurs qui ont fait d’Haïti un terrain d’étude pour dire la fiente, les crottes, la merde des chiens — en nous offrant leur compassion, mais pour continuer à dénoncer le mal et les ténèbres. Là, on doit se questionner : les prochains lieux campés, virtuels, inactifs ou morts. Ne le sommes-nous pas tout autant ? Nous avons vu un ambassadeur fédérer des gangs sous nos yeux, on regarde des gens armés, financés dans un pays qui ne produit ni n’abrite même pas une fabrique d’armement. Sommes-nous encore vivants ? Que reste-t-il encore vivant à Port-au-Prince comme espace de circulation ?

Certes, il y a des lieux de résistance. Mais disent-ils que nous sommes encore en vie ? On connaît un FOKAL comme espace de financiarisation de la culture, on le connaît controversé, mais il existait physiquement ; aujourd’hui, ses employés peuvent avoir un verre en main dans un bar à Crown Heights en parlant d’un projet pour Cité Soleil… qu’il faut cesser pour des raisons de sécurité ; le Centre d’Art, petit géant de la FOKAL, suit la même logique, il fonctionne virtuellement.
Le restaurant Bar Yanvalou surveille des heures pour fermer et les meilleurs moments pour ouvrir ses portes ; Araka, n’est plus ; il y a un directeur d’une Bibliothèque nationale qui gère un espace fermé ; une Direction nationale du Livre dont les portes sont aussi fermées, mais il y a un mois de cela, on a installé un directeur pour ladite direction ; les Vendredis littéraires comme espace de circulation de la mémoire littéraire d’Haïti, un espace de formation pour bon nombre d’écrivains haïtiens, aujourd’hui, ne fonctionnent pas.
Pyepoudre regarde ses directeurs forcés de partir pour d’autres pays ; l’université haïtienne n’existe qu’en ligne. En fait, pour de bon vivant, on questionne encore l’accessibilité, la pédagogie et la disponibilité pour les étudiants. Est-elle morte ou vivante ? Tous ces lieux, pourtant si divers, gardent une mémoire de leur existence, mais dans un temps passé. Ce qu’on brûle aujourd’hui, ce ne sont pas seulement des murs morts, c’est le feu qu’on met pour nous empêcher de penser les symptômes de la mémoire… Les traces du mal. C’est le feu aux dernières archives visibles du mal qui a donné ce qu’on a, ou ce qui aurait pu l’expliquer, ce qui aurait constitué un récit pour dire l’origine de quelque chose.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.