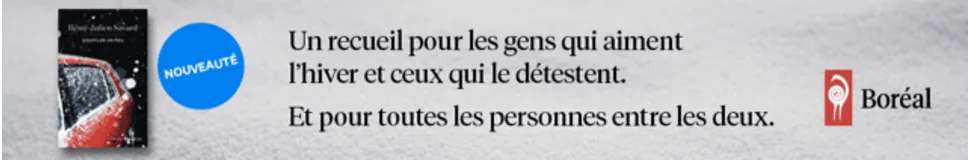Il y a des dates qui ne vieillissent pas. Elles restent suspendues dans le corps comme une cloche fêlée : on peut apprendre à vivre avec le son, mais on ne le fait jamais taire. Après le 12 janvier 2010, j’ai marché dans une ville qui ne savait plus comment se tenir debout. Tout semblait avoir perdu sa fonction : les rues n’étaient plus des rues, les maisons n’étaient plus des maisons, les mots eux-mêmes hésitaient. On disait « pays » par habitude, mais c’était un mot trop grand pour ce que j’avais sous les yeux. Je ne voyais plus un territoire, je voyais une absence. Une géographie sans promesse. Et ce jour-là, il y a eu le “Goudougoudou”, ce mot-onomatopée que tant d’Haïtiens utilisent pour imiter le bruit du sol et des secousses quand la terre a grondé.
Je me souviens de ce moment précis où l’on cesse de croire que l’État existe. Pas par idéologie, pas par colère, mais par simple observation. Tu regardes autour de toi, et tu comprends que personne ne viendra. Ou plutôt : que ceux qui viendront ne viendront pas à temps. Que l’aide, si elle arrive, arrivera comme une pluie tardive sur une terre déjà brûlée. À partir de là, tout se reconfigure : tu ne vis plus dans un pays, tu vis dans une survie. Tu n’habites plus, tu te réfugies. Tu ne planifies plus, tu improvises.
Et pourtant, même dans ce chaos, l’humain s’acharne à rester humain. On partage ce qu’on n’a pas. On donne une bouteille d’eau comme on donnerait une prière. On se met debout au milieu des ruines juste pour prouver à la peur qu’elle n’a pas gagné. Mais la dignité, aussi courageuse soit-elle, ne remplace pas un système. La dignité te maintient debout, elle ne te soigne pas. Elle te fait avancer, elle ne produit pas l’électricité. Elle te garde vivant, elle ne te rend pas l’avenir.
Je n’ai pas quitté mon pays comme on quitte une fête. Je l’ai quitté comme on sort d’un incendie : en gardant sur la peau l’odeur de la fumée. Quand je suis arrivé au Québec, je portais avec moi un mélange étrange : la gratitude d’être en vie et la honte de devoir recommencer. Car recommencer, pour un exilé, c’est souvent apprendre à sourire à des choses que d’autres trouvent normales.
Je dis « le Québec m’a accueilli » et je mesure la portée réelle de cette phrase. Accueillir, ce n’est pas seulement ouvrir une porte : c’est donner un cadre à quelqu’un qui arrive avec le désordre dans la tête. C’est dire : ici, tu vas pouvoir respirer sans demander la permission. Ici, ta vie ne sera pas suspendue au caprice d’un homme armé, ni à l’humeur d’un système qui n’a plus d’énergie pour te reconnaître.
Le Québec m’a accueilli dans un détail qui m’a frappé dès le début : la normalité. Une normalité parfois froide, parfois administrative, parfois trop carrée pour mon chaos intérieur : mais une normalité qui protège. J’ai découvert la beauté d’un monde où l’on fait la file et où la file a un sens. Où l’heure d’un rendez-vous n’est pas un poème abstrait, mais un engagement. Où les lois ne sont pas parfaites, mais existent assez pour qu’on puisse s’y adosser.
Je le dis sans détour : avoir accès aux soins de santé, c’est un choc culturel quand on vient d’un endroit où la maladie te négocie à l’avance. Au Québec, j’ai compris quelque chose de simple et de bouleversant : on ne te demande pas d’être riche pour être soigné. On te demande d’être humain.
Je n’idéalise pas. Je sais qu’il y a des attentes, des couloirs, des urgences pleines, des rendez-vous qui prennent du temps. Mais même ces critiques-là sont, à leur manière, un luxe : elles supposent l’existence d’un système. Elles supposent qu’on peut se plaindre parce qu’il y a quelque chose à améliorer. Moi, j’ai connu l’autre monde, celui où l’on ne se plaint pas, parce qu’il n’y a rien. Celui où l’ambulance devient un mythe. Celui où l’hôpital ressemble à un naufrage. Alors oui : quand on a tout perdu, on reconnaît un pays à sa capacité de soigner. Pas seulement de guérir, mais de prendre en charge. De dire : ta douleur n’est pas un détail. Ta vie ne sera pas laissée au hasard.
Puis il y a eu les études. Et là encore, j’ai ressenti cette sensation rare : être pris au sérieux. Dans mon pays d’origine, l’éducation était une bataille, parfois un privilège, souvent une loterie. Au Québec, j’ai découvert une autre logique : l’éducation comme investissement collectif. Comme promesse tenue à l’avance. Comme pacte silencieux entre une société et ses enfants : et, oui, même ses nouveaux arrivants.
J’ai connu des professeurs qui corrigent avec exigence, mais aussi avec cette idée-là au fond : on ne te fait pas apprendre pour t’humilier, on te fait apprendre pour te construire. J’ai appris une langue dans la langue : le français du Québec, avec ses tournures, sa musique, ses expressions qui font sourire et qui, un jour, deviennent les tiennes. J’ai appris que l’intégration n’est pas un test humiliant, mais une conversation longue, parfois difficile, souvent belle.
Je me souviens du premier moment où je me suis senti légitime : pas seulement toléré, pas seulement « accueilli », mais utile. Ce moment où l’on cesse d’être “le nouvel arrivant” et où l’on devient simplement quelqu’un qui contribue. Quelqu’un qui étudie, qui étudie, qui paie ses impôts, qui prend le bus, qui se plaint du froid, qui rit d’un accent, qui s’en forge un autre.
Depuis peu, je bouge dans la région d’Ottawa–Gatineau, au rythme des obligations et des ponts. J’habite Ottawa, non pas par reniement, mais parce que mon chemin professionnel m’y ancre, simplement. Pourtant, je reste encore, en partie, du côté du Québec par mes habitudes, mes attaches, mes retours, mes réflexes. Et si mes pas ont changé de rive, mon cœur, lui, est resté sous un lampadaire à Montréal : c’est ma façon la plus vraie de dire aux Québécois que je suis, et que je reste, québécois.
Le travail a été une autre étape de ce retour à la dignité. Dans les pays où l’État s’effondre, le travail devient un sport extrême : on survit dans l’informel, on négocie chaque jour, on se débrouille, on ruse. Ici, j’ai découvert le travail encadré, avec des repères qui tiennent. Des horaires. Des droits. Des normes. Une protection qui change la vie, parce qu’elle te retire de la loi du plus fort.
Et c’est un choc de comprendre qu’on peut construire quelque chose sans devoir payer une taxe à la peur. Qu’on peut planifier un mois, parfois une année. Qu’on peut parler de carrière, pas seulement de “petits boulots”. Qu’on peut avoir un CV qui est autre chose qu’une liste de survies. Le Québec m’a donné cette possibilité-là : ne plus être seulement un homme qui fuit, mais un homme qui bâtit. Ne plus être un dossier en transit, mais une personne en chemin.
Je vais dire une chose qui fera peut-être sourire : l’électricité 24 heures sur 24, c’est une révolution intérieure. Dans mon pays d’origine, la lumière est une négociation permanente. On apprend à vivre avec les coupures comme on apprend à vivre avec les promesses : en n’y croyant pas trop. Ici, la lumière est là. Simplement. On appuie sur l’interrupteur et le monde répond. C’est un détail, oui, mais un détail qui résume une civilisation : la continuité. La fiabilité. L’idée qu’une société fonctionne même quand tu ne la regardes pas. Que les services ne dépendent pas de ton courage, mais d’une organisation collective.
Quand on a connu l’obscurité imposée, on comprend ce que signifie une ville éclairée : ce n’est pas seulement du confort, c’est de la sécurité. C’est la possibilité d’étudier le soir. De travailler. De rentrer chez soi. D’imaginer. De respirer. Et dans cette lumière stable, j’ai compris ce que je n’avais plus vu depuis longtemps : un pays, ce n’est pas une émotion. C’est une infrastructure morale. Une manière d’assurer aux gens un minimum de stabilité pour qu’ils puissent redevenir pleinement humains.
Ma gratitude envers le Québec n’est pas un slogan. C’est une reconnaissance concrète, presque quotidienne. Je la vois dans les trottoirs déneigés qui te permettent de marcher sans te battre contre la rue. Dans les bibliothèques où l’on peut entrer gratuitement et ressortir plus riche. Dans les autobus qui passent malgré l’hiver. Dans l’idée simple qu’un inconnu peut te dire bonjour sans arrière-pensée.
Je sais aussi que le Québec a ses tensions, ses débats, ses fatigues, ses colères. Je ne viens pas faire de la carte postale. Mais quand on vient d’un monde où tout peut s’effondrer en quelques secondes, on apprend à aimer les sociétés qui tiennent. Même quand elles doutent. Même quand elles se critiquent. Car se critiquer, c’est déjà croire qu’on peut améliorer.
Après le 12 janvier 2010, je ne voyais plus de pays. Je voyais un vide, un trou dans la terre et dans la confiance. Le Québec, lui, m’a offert quelque chose de plus rare qu’une aide : une structure. Une chance. Une continuité. Il m’a permis de me reconstruire sans avoir à m’excuser d’exister. Et aujourd’hui, quand je pense à cette date qui ne vieillit pas, je pense aussi à une autre chose : la preuve que la vie peut recommencer. Que l’exil, malgré sa douleur, peut devenir une deuxième naissance. Et que la gratitude, quand elle est sincère, n’est pas une faiblesse : c’est une forme de justice rendue à ceux qui t’ont tendu la main.
Parce qu’au fond, je n’ai pas seulement trouvé un endroit où vivre : j’ai trouvé un pays, oui, je le dis ainsi, et je l’assume, même si je sais très bien ce que disent les cartes et les constitutions. J’ai trouvé un pays dans une langue. Et la langue qui m’a accueilli n’était pas seulement le français “en général” : c’était le français du Québec, avec ses “bon matin”, ses “c’est correct”, ses “viens-t’en”, ses silences polis, ses élans, ses pudeurs, ses façons de dire sans écraser. J’ai trouvé un pays dans des gens aussi : des Québécois qui m’ont tendu la main sans me demander de renier ce que j’étais, qui m’ont appris, parfois sans le savoir, que l’accueil n’est pas un discours mais un geste, une place faite à table, un conseil donné, un regard qui n’humilie pas, une patience qui ne se vante pas. Alors oui, je sais : le Québec n’est pas un pays au sens strict, pas “officiellement”.
Mais j’ai rarement vu une nation avec autant de preuves quotidiennes de ce qu’est un pays : une école qui ouvre, une clinique qui soigne, une bibliothèque qui éclaire, une société qui se tient, un peuple qui défend sa langue comme on défend une maison, non pour exclure, mais pour continuer d’exister. Et cela, pour un homme qui, un jour, ne voyait plus de pays, c’est plus qu’un refuge : c’est une identité qui recommence, une confiance qui se reconstruit, une idée du possible qui reprend chair, au point qu’ici, j’ai compris ceci : il y a des peuples qui n’attendent pas qu’on leur donne un pays, parce qu’ils en portent déjà un, debout, dans la voix, dans la mémoire, et dans la façon d’avancer.
________________________P.S. — Depuis le 23 décembre 2025, mes chroniques sur Facebook sont prises en otage : ma page a été piratée. J’ai multiplié les démarches, les formulaires, les signalements ; jusqu’ici, toutes mes tentatives sont restées vaines, et il est presque impossible d’entrer en contact avec un humain du côté de Facebook. En attendant de récupérer l’accès, si vous souhaitez faire circuler ce texte, je vous serais reconnaissant de partager vous-mêmes mes chroniques sur vos profils ou vos pages : c’est, pour l’instant, la seule façon simple de leur donner une chance d’exister malgré ce silence numérique. (Retrouvez-moi : Ici sur X.) Laissez vos commentaires.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.