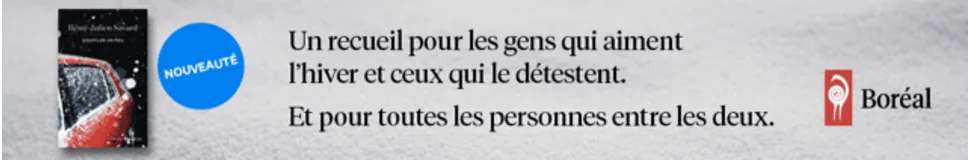C’est dans les bayous les plus fétides, là où même les moustiques hésitent avant de piquer, que l’idée lumineuse a jailli : construire une prison sur pilotis.
Pas pour des criminels endurcis, pas pour des psychopathes au sang froid, non. Pour des mères, des pères, des enfants, dont le crime le plus grave aura été de croire qu’un pays qui vendait du rêve à la télé ne vendait pas aussi des cauchemars en coulisses.
Bienvenue dans l’Amérique swampy, version 2025, où l’on « entrepose » des êtres humains comme de la vieille marchandise moisie. Dans un entre-deux poisseux, à mi-chemin entre le parc à alligators et le camp de rétention.
Et dans cette farce tragique, Donald Trump n’a rien trouvé de mieux que de se moquer publiquement des migrants en situation irrégulière qui seront prochainement enfermés dans ces zones hostiles.
Lors d’une visite dans les marécages de Floride, il a lancé avec un rire gras : « On a beaucoup de flics sous forme d’alligators, vous n’avez pas besoin de les payer autant. » Et d’ajouter, hilare : « Je ne voudrais pas courir longtemps dans les Everglades. Ça gardera les gens où ils sont censés être. » Le spectacle est total : des vies humaines réduites à une blague, à un chiffre, à une masse qu’on peut contenir grâce à la nature sauvage et à l’humour noir du populisme.
Et pendant que l’on cloue des baraquements sur des radeaux de vase, sous les yeux torchés de caméras bien placées, un homme coiffé d’un casque orange — la seule chose probablement authentique chez lui — s’en vante sans la moindre gêne. Les mots coulent de sa bouche comme du sirop de maïs : sucrés, collants, mais toxiques à haute dose.
Il appelle ça une victoire. Il appelle ça une stratégie. Il appelle ça America First. Moi, j’appelle ça un camp. Oui, un camp. Vous savez, ces endroits qui reviennent toujours dans l’Histoire quand on a trop oublié ce qu’elle nous enseignait.
Ce n’est pas la première fois que l’actuel président américain exprime une obsession carcérale à l’égard des migrants : il avait même évoqué dans le passé vouloir rouvrir la prison mythique d’Alcatraz, à San Francisco, pour y enfermer les sans-papiers (à ne pas confondre avec « l’Alcatraz des alligators » de Floride). Ce célèbre pénitencier fédéral, fermé en 1963, qui a jadis retenu des figures emblématiques comme Al Capone ou Robert Stroud, est aujourd’hui un site historique national. En 2018, Donald Trump avait suggéré de le « réactiver » pour y isoler certains détenus jugés indésirables, y compris des migrants sans statut légal. Une idée aussi grotesque que symbolique, transformant un lieu chargé d’histoire pénitentiaire en musée de la xénophobie contemporaine.
Mais où sont donc passés les cris d’indignation planétaire ? Où sont les Unes de journaux en lettres capitales ? Où sont les diplomates, les intellectuels, les bonnes âmes toujours promptes à dénoncer la moindre entorse aux droits humains… à condition que ce ne soit pas Washington qui les piétine ?
Ah, j’ai compris. C’est parce que l’homme en question ne porte pas de treillis. Il ne fume pas de cigare sur fond de jungle. Il n’a pas pris le pouvoir avec des kalachnikovs, mais avec des tweets. Il ne fait pas taire ses opposants dans les caves humides, mais dans l’algorithme des réseaux sociaux. Il n’interdit pas les élections, il les redéfinit. Il ne crie pas, il ricane. Bref, il est présentable. Il parle anglais. Il a son jet privé. Il mange bio (enfin, je suppose). Il boit de l’eau filtrée — ou du soda light, qui sait. Il a la gueule de l’Empire. Voilà donc une tyrannie version faible en sucre, à digestion lente, servie sur plateau médiatique.
Et derrière cette rhétorique de plus en plus brutale, c’est tout un système qui s’active : aujourd’hui, plus de 59 000 personnes seraient déjà détenues par la police de l’immigration américaine, l’ICE, un appareil devenu tentaculaire sous les derniers mandats républicains (source: Associated Press). Des familles, des travailleurs, des réfugiés, pris dans les mailles d’un filet de plus en plus étroit et inhumain.

Une terre promise devenue un parking à expulsions
Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas ici d’un débat sur l’immigration. Il s’agit d’un effondrement moral. Pendant que l’Europe se perd en querelles bureaucratiques sur le nombre de sandwichs par demande d’asile, les États-Unis, eux, déroulent des rouleaux de barbelés devant leurs portes, quand ils ne les jettent pas dans le marécage le plus proche.
On expulse à tour de bras. On rature des vies. On efface des présences comme des taches sur une nappe blanche.
Ce que l’on appelle pudiquement « statut temporaire » devient une sorte de contrat piégé : tu peux vivre ici, mais ne te crois jamais chez toi. Tu peux payer tes taxes, élever tes enfants, bâtir ta maison… mais à tout moment, un homme au brushing impeccable peut signer un décret et t’arracher à ta chaise. Tu n’es pas un citoyen, tu es un sursis.
Le plus ironique ? C’est qu’on offre cette sentence à ceux qui, souvent, ont fui l’enfer pour quelques miettes de ciel. On oublie que nombre de ces Haïtiens, Vénézuéliens, Honduriens, vivent aux États-Unis depuis plus d’une décennie. Certains y ont fondé des familles, bâti des entreprises, contribué à l’économie, lavé les trottoirs, changé les draps des hôtels, cuisiné pour des sénateurs.
Mais dans la nouvelle Amérique de l’homme orange, cela ne suffit plus. Il faut une pureté géographique. Une généalogie estampillée Native Born Patriot. Comme si le sol américain appartenait à ceux qui l’ont sali les premiers. Et maintenant, il accueille, dans ce même esprit, des Afrikaners blancs d’Afrique du Sud, prétendument persécutés “à cause de leur couleur de peau”. En mai 2025, environ 59 Sud-Africains blancs—principalement des fermiers afrikaners—ont été rapatriés en urgence aux États-Unis sous le statut de réfugiés, sur la base d’un décret invoquant un “génocide” racial dont, pourtant, les autorités sud-africaines, des magistrats et plusieurs experts indépendantset disent qu’il n’existe aucune preuve.
Là où d’autres imposent le silence, Trump orchestre le vacarme. Il ne met pas ses opposants en prison : il les noie sous le ridicule. Il ne censure pas : il inonde. Il ne frappe pas : il désinforme. Mais l’effet est le même. Les voix critiques s’essoufflent, les médias s’essuient les lunettes, les institutions baissent les yeux, et l’opinion publique confond la lassitude avec le consentement. Pourquoi n’est-il pas allé plus loin ? Parce qu’il en est encore empêché — pour l’instant — par les garde-fous fragiles d’une démocratie cabossée : des juges qui résistent, une presse libre qui s’accroche malgré l’épuisement, des citoyens vigilants, des États qui freinent, et une Constitution que l’on tord mais qui n’a pas encore cédé. C’est ce qui l’empêche, pour l’instant, d’envoyer réellement ses opposants derrière les barreaux, de bâillonner les journalistes, de transformer le mensonge en vérité d’État sans obstacle. Mais l’intention y est. Le désir aussi. Et l’Histoire nous apprend qu’il suffit d’un glissement, d’une crise, d’un prétexte pour que l’ironie bascule dans la terreur.
Où sont les voix ?
Car voyez-vous, une dictature ne porte plus forcément d’uniforme. Elle peut désormais s’habiller en costume trois pièces, sourire aux caméras, signer des contrats et même écrire des livres. Ce n’est pas une dictature sanglante. C’est une dictature propre. Éthique. Sans gras trans. Certifiée USDA. Une tyrannie cosmétique.
Et pendant qu’on tergiverse sur les nuances sémantiques, des milliers de personnes reçoivent des avis de renvoi. En septembre de cette année ou en février prochain, on leur dira poliment que leur présence n’est plus souhaitée. Qu’ils avaient signé un pacte invisible avec le sol américain. Et que ce pacte est arrivé à expiration. Comme une conserve. Comme un mot de passe.
Alors je pose la question : que faut-il pour que le monde se réveille ? Que faut-il pour que les grands quotidiens titrent « Le despote américain récidive » ? Pourquoi tant de gorges se nouent quand il s’agit de critiquer l’Amérique ? Est-ce par admiration ? Par peur ? Par paresse intellectuelle ?
Qu’importe. Il est temps d’appeler un déporteur un déporteur. Un homme qui jette des familles dans le désespoir comme on efface un brouillon n’est pas un leader. Il est le fantôme d’une démocratie défunte.
Et si nous ne disons rien aujourd’hui, que dirons-nous demain ? Quand l’histoire s’écrira, que resterait-il de notre silence complice ? Allons-nous prétendre que nous ne savions pas ? Que les moustiques du marécage ont été les seuls témoins ?
Vous pouvez rire. Vous pouvez trouver ce texte exagéré. Mais à ceux qui regardent ailleurs, qui haussent les épaules en soupirant « c’est comme ça », je dis : il n’y a pas de dictature douce. Il n’y a que des citoyens qui ont oublié qu’ils avaient une voix. Et des gouvernements qui testent jusqu’où ils peuvent aller.
Donald Trump n’a pas inventé la peur. Il l’a rendue rentable.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.