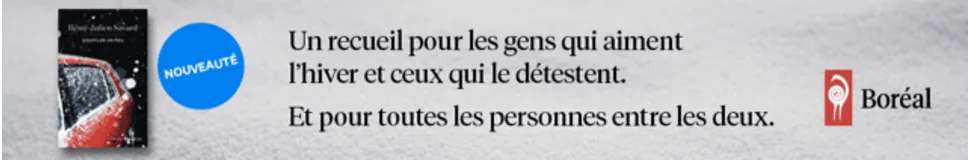En mémoire de Karl Tremblay, deux ans déjà…
On ne sait jamais vraiment comment on entre dans un pays. Certains passent par l’aéroport, d’autres par les papiers, d’autres encore par les tempêtes de neige qui vous giflent le visage comme pour dire : « Bienvenue, mon grand, ici, tu devras apprendre à marcher autrement. » Moi, je suis entré au Québec par une chanson. Par quatre accords qui vibraient un soir dans un auditorium d’école primaire, dans un quartier où je louais un sous-sol qui sentait l’amitié et la soupe du dimanche.
C’est un voisin, ou plutôt ce propriétaire du duplex, installé juste au-dessus de mon petit appartement dans Rosemont–La Petite-Patrie, qui m’avait adopté comme un cousin tombé du ciel. Un soir, il m’avait lancé avec son franc sourire : « Viens voir mon garçon chanter avec ses chums, tu vas aimer ça. » Pas de protocole, pas de grand discours. Juste des parents fiers comme seuls les Québécois savent l’être, et des enfants dont la nervosité battait plus fort que les feuilles qui frémissent aux premiers vents d’automne.
Puis ils ont commencé.
Et là, dans ma vie d’immigrant qui essayait encore de comprendre le sens mystique du mot « cabane à sucre », j’ai entendu « Plus rien » pour la première fois. Je n’ai pas compris tout de suite que cette chanson allait fissurer quelque chose en moi. Mais les voix d’enfants qui racontent la fin du monde, ça touche différemment. Ça dérange. Ça plante un drapeau.
À la fin, j’ai demandé :
— C’est qui ça, les Cowboys Fringants ?
On m’a répondu comme on répond à quelqu’un qui vient de découvrir la poutine :
— Ah ben là… t’es en retard, mon chum. Faut que tu rattrapes ça.
Le lendemain, je suis allé chez Archambault. J’ai acheté l’album « La Grande-Messe », j’ai fouillé, j’ai lu sur les artistes (JF Pauzé, Marie-Annick Lépine, Jérôme Dupras et Karl Tremblay), j’ai regardé des entrevues, j’ai écouté en boucle. C’était aussi simple que ça : le Québec venait de se loger dans ma vie par la porte dérobée de la musique. Et moi, qui croyais qu’on s’intégrait par l’accent ou les formulaires, je découvrais qu’en réalité, on s’intègre par les chansons qu’on apprend à connaître, par les refrains qu’on se surprend à fredonner sans accent, par les histoires qui deviennent un peu les nôtres.
Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans une salle de spectacle, au milieu d’un public debout, vibrant. J’ai vu Karl Tremblay et les autres sur scène au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Il avait cette manière de tenir un micro comme on tient une vérité fragile : sans prétention, sans artifice, avec une sincérité qui ne triche pas. Ce soir-là, j’ai compris pourquoi un peuple entier considérait ce groupe comme une famille élargie.
Les Cowboys, c’était l’humour, la poésie, la critique sociale, le cœur sur la table, la simplicité dans le grand. C’était aussi ça, le Québec : une profondeur sans fla-fla, une fraternité qui n’a pas besoin de mots compliqués, un pays capable de rire de lui-même sans cesser de s’aimer.
Puis, le 15 novembre 2023, à la Une des journaux.
Karl était parti.
J’ai eu l’impression que le sol bougeait sous mes pieds. Pas un petit tremblement, non. Un séisme. Un bruit sourd dans la poitrine. Comme si un géant venait de tomber et que tout le monde, d’un seul coup, se sentait plus petit. Le Québec a pleuré. Moi aussi. Les artistes qu’on aime ne font jamais vraiment partie de notre famille, mais ils habitent nos souvenirs avec la même intimité.
Deux ans plus tard, on s’ennuie encore de lui.
Chaque jour un peu.
Chaque fois qu’un refrain commence.
Chaque fois que la neige tombe comme dans « Les étoiles filantes ».
Chaque fois qu’une foule chante « Marine marchande » en cœur.
Chaque fois qu’on se rappelle qu’une voix peut devenir un pays.
« PLUS RIEN » – Les Cowboys Fringants
Il y a une ironie incroyable à se dire que j’ai découvert les Cowboys Fringants par une chanson qui parle de la fin du monde. Parce qu’à travers cette apocalypse poétique, ce que j’ai réellement reçu, c’est une leçon de vie québécoise : ici, même quand tout fout le camp, on chante encore. On rit, on dénonce, on espère.
Et cette chanson « Plus rien », je recopie ici un long extrait, parce que certaines œuvres ne s’expliquent pas, elles se portent :
(…)
Tout ça a commencé il y a plusieurs années
Alors que mes ancêtres étaient obnubilés
Par des bouts de papier que l’on appelait argent
Qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants
Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien
Étaient prêts à tout pour arriver à leurs fins
Pour s’enrichir encore, ils ont rasé la terre
Pollué l’air ambiant et tari les rivièresMais au bout de cent ans, des gens se sont levés
Et les ont avertis qu’il fallait tout stopper
Mais ils n’ont pas compris cette sage prophétie
Ces hommes-là ne parlaient qu’en termes de profits
C’est des années plus tard qu’ils ont vu le non-sens
Dans la panique ont déclaré l’état d’urgence
Quand tous les océans ont englouti les îles
Et que les inondations ont frappé les grandes villesEt par la suite pendant toute une décennie
Ce furent les ouragans et puis les incendies
Les tremblements de terre et la grande sécheresse
Partout sur les visages, on lisait la détresse
Les gens ont dû se battre contre les pandémies
Décimés par millions par d’atroces maladies
Puis les autres sont morts par la soif ou la faim
Comme tombent les mouches, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien
Plus rien
Plus rien(…)
Cette chanson, c’est un testament écologique. Un avertissement. Une fable. Une prière. Un miroir aussi. Mais pour moi, elle restera surtout le premier pont que j’ai traversé vers ce pays où les gens disent « Bon matin ! » avec une chaleur tellement pure que ça réconcilierait deux ennemis jurés.
Les Cowboys Fringants m’ont appris le Québec avant même que je sache l’habiter. Karl Tremblay m’a montré qu’une voix peut rassembler un peuple entier. Et depuis ce premier soir, je marche dans ce coin du monde avec un refrain dans la poche.
Deux ans déjà que Karl n’est plus là.
Le manque reste bien réel.
Et lorsque la foule s’élève en chœur, on entend encore son empreinte dans chaque refrain. Parce que certains artistes ne meurent jamais : ils se transforment en pays.
Quand une voix devient pays
Il y a des voix qui ne meurent pas.
Elles changent simplement de domicile.
Elles quittent le corps pour entrer dans les foules,
elles délaissent la scène pour habiter la mémoire.
La tienne, Karl, s’est logée dans les interstices du Québec :
entre deux sapins, dans les rues où la neige hésite avant de tomber,
dans les soupers de famille où quelqu’un finit toujours par dire :
« Peux-tu mettre les Cowboys ? Ça fait longtemps… »
Elle est dans les fêtes d’école,
dans les camps de vacances,
dans les road trips vers le Lac,
dans les 5 à 7 où on parle du pays comme s’il nous appartenait tous
mais où, secrètement, c’est toi qui le portais.
Tu as chanté la terre,
le monde qui déraille,
les amours qui collent,
les rêves qui tiennent debout même quand le vent souffle trop fort.
Et nous, on t’a suivi.
Parce que tu chantais ce qu’on vivait
avant même qu’on le vive.
Tu étais la preuve qu’une chanson peut être une patrie,
qu’un refrain peut tenir lieu d’étendard,
qu’un artiste peut incarner un peuple sans jamais se prendre pour un prophète.
Il y a deux ans, le 15 novembre,
le Québec a perdu un chanteur
mais a gagné une légende.
Une légende modeste,
qui aurait rougi d’entendre qu’on parle de lui comme ça,
mais qui aurait souri en coin
en voyant les foules pleurer et chanter en même temps.
Et aujourd’hui encore,
quand les voix s’élèvent dans les arénas,
quand les guitares s’allument dans les salons,
quand un enfant, comme celui que j’ai vu,
reprend « Plus rien » avec un sérieux de vieil homme,
on sent ton souffle au milieu du chant.
Tu n’es plus là,
mais tu continues d’apparaître
dans chaque note juste,
chaque foule debout,
chaque cœur qui se réchauffe un peu trop vite.
On dit souvent que le Québec, c’est un pays qui n’a jamais réussi à se faire.
Moi, je crois l’inverse :
le Québec existe.
Il est là,
dans cette façon qu’on a de te chanter encore,
comme si chaque voix qui s’ajoute
venait compléter ton absence.
Karl,
tu as quitté la scène,
mais pas le pays.
Tu as quitté la vie,
mais pas les vivants.
Tu as quitté ton corps,
mais pas nos mémoires.
Et tant que les foules auront un souffle,
tu ne manqueras jamais d’air
Parce qu’une voix comme la tienne
ne disparaît pas.
Elle se dépose.
Elle se transforme.
Elle devient un territoire entier.
Un pays chanté.
Un pays partagé.
Un pays qui sait encore dire
« On est ensemble »
même quand la lumière s’éteint.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.