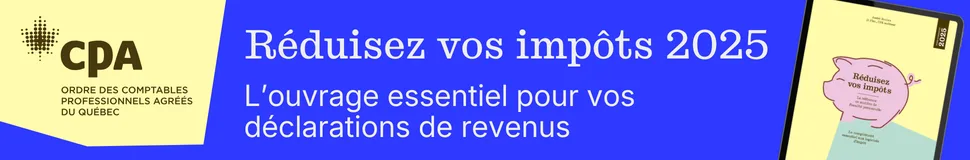car dans ma lente marche de Poète
j’ai vu ô mon Pays tes enfants sans mémoire
dans toutes les capitales de l’Amérique
le coui tendu et toute fierté bue
genoux ployés devant le dieu-papier
à l’effigie de WashingtonÀ quoi bon ce passé de douleurs et de gloire
et à quoi bon dix huit cent quatreAnthony Phelps, « Mon Pays Que Voici »
Le 1er janvier revient chaque année comme une date immuable, avec la régularité d’un rite qu’on n’interroge plus. Un rituel gravé dans la pierre, un anniversaire que l’on répète mécaniquement, parfois avec fanfare, parfois avec fatigue, souvent avec une gravité qui confine à la récitation scolaire. Une date sacrée, figée, presque fossilisée. 1804. Le chiffre est devenu talisman, fétiche, bouclier symbolique. On le brandit comme une preuve d’existence, comme un certificat de naissance qu’on sortirait à chaque fois que le monde doute de nous – ou que nous doutons de nous-mêmes. On la récite comme une prière, on la commémore comme un réflexe. Pourtant, plus le temps passe, plus une question s’impose, insistante, brutale, presque indécente : et à quoi bon 1804, si nous n’avons rien su en faire ?
Je pose cette question depuis un lieu paisible, stable, organisé. Une société qui n’a pas eu besoin d’une rupture violente pour comprendre que la liberté n’est pas un cri, mais une architecture patiente. Une société où la liberté n’est pas un slogan mais une mécanique quotidienne : institutions fonctionnelles, lois respectées, désaccords civilisés, débats sans machettes, élections sans deuil. Ici, la liberté est un acquis qu’on discute, qu’on ajuste, qu’on revendique encore – parfois avec passion, parfois avec impatience – mais toujours dans le cadre d’un ordre commun accepté. C’est depuis cet ailleurs que 1804 me revient en pleine figure, non comme une simple fierté, mais comme une douleur mal digérée, une promesse interrompue.
Car l’histoire haïtienne, à force d’être invoquée, a fini par être figée. On l’admire, on la vénère, on la sanctifie, mais on la laisse mourir de solitude. 1804 n’est plus un point de départ, c’est un refuge rhétorique. On s’y abrite pour éviter de regarder le présent en face. On répète que nous avons été les premiers, que nous avons osé l’impensable, que nous avons renversé l’ordre du monde esclavagiste, raciste et colonialiste. Tout cela est vrai. Absolument vrai. 1804 fut immense. Une anomalie historique. Une gifle infligée à l’ordre mondial. Des esclaves devenus maîtres de leur destin. Des corps brisés qui ont osé dire non. Une victoire si radicale qu’elle a effrayé la planète entière. Mais l’histoire n’est pas un musée : elle exige des héritiers capables de la prolonger, pas seulement de la vénérer – capables de traduire une mémoire en projet durable.
Les dérives commencent peut-être là : dans cette confusion entre mémoire et projet. L’indépendance devait être une promesse de dignité, elle est devenue un alibi. Alibi pour des élites qui pillent au nom du drapeau. Alibi pour des dirigeants qui confondent pouvoir et revanche. Alibi pour une société qui célèbre le passé pour ne pas affronter l’effondrement du présent. On a transformé la liberté en slogan, la souveraineté en excuse, l’autonomie en abandon. Être libre, en Haïti, a trop souvent signifié être livré à soi-même, sans institutions solides, sans règles partagées, sans horizon collectif – comme si l’autodétermination pouvait exister sans autodiscipline.
Il y a dans l’histoire haïtienne une accumulation d’absurdités si cohérentes qu’elles finissent par former un système. Une révolution victorieuse qui débouche sur une dette coloniale. Une nation née dans la radicalité qui se normalise dans la médiocrité politique. Une élite noire qui reproduit les réflexes de l’ancienne élite coloniale. Une armée fondatrice qui devient une force de déstabilisation permanente. Des constitutions écrites comme des manifestes, aussitôt piétinées. On en a écrit plus qu’on n’a construit d’écoles. On les a changées à chaque régime, comme si le problème venait toujours du texte, jamais de l’homme. Une constitution pour rassurer, une autre pour exclure, une autre pour verrouiller, une autre pour flatter. Le droit est devenu décoratif – au lieu d’être ce socle discret qui permet à une société de durer sans s’autodétruire.
On a longtemps accusé l’extérieur, parfois à juste titre, souvent par facilité. Oui, Haïti a été puni pour avoir osé. Oui, le monde esclavagiste n’a jamais pardonné l’audace de 1804. Oui, les interventions étrangères ont laissé des cicatrices profondes. Mais soyons honnêtes : on ne peut pas passer deux siècles à accuser l’extérieur pour masquer l’effondrement intérieur. Car l’histoire n’explique pas tout. Elle éclaire, elle conditionne, mais elle n’excuse pas l’acharnement à mal faire. À un moment donné, l’absurde cesse d’être hérité, il devient entretenu – et même revendiqué au nom d’une souveraineté mal comprise.
Le plus tragique, peut-être, c’est que la liberté haïtienne a été confondue avec l’absence de limites. Comme si se gouverner soi-même signifiait se libérer de toute contrainte, de toute discipline collective, de toute exigence institutionnelle. L’autorité avec la tyrannie. L’État avec l’ennemi. Gouverner avec voler. Critiquer avec détruire. Résister avec bloquer. Penser avec crier. Et l’absurde s’est installé comme mode de gestion, là où d’autres sociétés ont compris que la liberté réelle commence souvent là où l’arbitraire s’arrête.
On a commencé par tuer les pères fondateurs. Puis par effacer leur pensée. Ensuite par mythifier leurs statues tout en piétinant leurs idées. On a transformé Dessalines en icône figée, pendant que l’on sabotait méthodiquement l’État qu’il voulait bâtir. On a glorifié la rupture, sans jamais construire la continuité – comme si toute stabilité était suspecte, comme si durer était déjà trahir.
La présidence est devenue un billet de loterie. On n’y entrait plus pour servir, mais pour se servir. Le pouvoir n’était plus une responsabilité, mais une revanche sociale. On gouvernait comme on se venge. On pillait comme on respirait. Et quand le peuple protestait, on invoquait 1804, comme un alibi magique – comme si l’histoire pouvait encore absoudre l’absence de gouvernance.
Puis est venue la culture du provisoire éternel. Gouvernements de transition, autorités temporaires, accords intérimaires, consensus fragiles. Haïti est devenue une salle d’attente sans médecin. On attend toujours quelque chose : des élections, une aide, une solution, un sauveur. L’État n’agit plus, il survit – là où d’autres peuples ont appris que l’autonomie passe d’abord par la continuité.
Pendant ce temps, l’école s’est effondrée. La transmission s’est rompue. L’histoire n’est plus enseignée, elle est récitée. On connaît les dates, pas les idées. Les slogans, pas les structures. Les héros, pas les mécanismes. Résultat : une jeunesse sans boussole, sans horizon, sans confiance dans le collectif – incapable de se projeter dans un avenir commun parce qu’on ne lui a jamais appris comment se construit un pays normal.
Et comme l’État s’est retiré, les gangs sont entrés. Pas par accident. Par invitation tacite. Parce que le vide appelle toujours le plus violent. Les armes ont remplacé la loi. Les chefs de quartiers ont remplacé les maires. La peur a remplacé la citoyenneté. Et l’indépendance est devenue territorialement morcelée, confisquée par des hommes armés.
Un matin récent, dans un quartier ordinaire de la capitale, l’indépendance s’est réveillée avant le soleil, comme elle le fait désormais : par le bruit sec des armes. Des gangs ont attaqué à l’aube. Des habitants ont été tués. D’autres ont fui en courant, non pas vers un avenir, mais vers un coin de ville qui n’avait pas encore été avalé. Rien d’exceptionnel, rien de symbolique : une rue, des maisons, des vies ordinaires abandonnées à la hâte, avec cette sensation humiliante de quitter sa propre existence comme on fuit un incendie qu’on n’a pas allumé. Dans ce pays, l’exil intérieur est devenu une routine, et la souveraineté, lorsqu’elle ne protège plus les corps, devient un mot vide, un drapeau agité au-dessus d’une population qui déménage sa peur d’un quartier à l’autre.
Haïti est alors passée de pays indépendant à otage armé de lui-même.
Ajoutons à cela l’élite économique, souvent absente, parfois prédatrice, toujours déconnectée. Une bourgeoisie sans projet national, sans devoir collectif, sans patriotisme concret. Elle investit ailleurs, éduque ses enfants ailleurs, soigne ses maladies ailleurs, tout en donnant des leçons de souveraineté à ceux qui meurent sur place – comme si l’amour d’un pays pouvait se limiter à un discours sans engagement réel.
Ajoutons encore la diaspora, indispensable économiquement, ignorée politiquement. On encaisse ses transferts, mais on refuse sa voix. On la célèbre quand elle envoie de l’argent, on la méprise quand elle veut participer. 1804 devient alors une frontière morale : libre de payer, pas libre de décider – une conception étroite de la nation, incapable d’intégrer toutes ses forces vives.
Et puis il y a la santé, ce révélateur brutal de ce qu’il reste encore debout. Quand un hôpital ferme parce que l’insécurité l’étouffe, ce n’est pas seulement une porte qu’on verrouille : c’est une société qui avoue qu’elle ne sait plus protéger ses vivants. Des centres hospitaliers ont dû cesser leurs activités, des équipes médicales ont évacué sous la menace, des soignants ont quitté leur poste non par lâcheté, mais parce que même l’acte de soigner est devenu dangereux. Voilà où en est 1804 : dans la possibilité très réelle qu’un médecin, une infirmière ou un patient deviennent des cibles secondaires dans une guerre où l’État n’est plus arbitre, mais spectateur tremblant.
Et puis il y a le théâtre international. Les grandes puissances qui condamnent sans réparer, qui aident sans comprendre, qui interviennent sans assumer. Même le ciel, désormais, a ses barrières : des vols commerciaux restent interdits, prolongés pour des raisons de sécurité, parce que des groupes armés ont acquis une capacité de nuisance telle qu’elle atteint jusqu’aux trajectoires d’avion. On a connu l’indépendance comme conquête du sol ; voici l’indépendance comme impossibilité de décoller. Et l’image la plus cruelle est peut-être celle-ci : lors d’une opération récente, un hélicoptère a dû être détruit par les forces de l’ordre elles-mêmes, par crainte qu’il ne tombe entre les mains de gangs. Un État qui brûle son propre matériel pour éviter qu’il ne serve à ceux qui le défient : difficile de trouver parabole plus précise d’une liberté malade, obligée de se mutiler pour survivre.
Mais là encore, la vérité dérangeante s’impose : l’histoire pèse, oui. Mais elle n’excuse pas tout. À un moment, l’irresponsabilité devient un choix. Alors, à quoi bon 1804, si l’indépendance ne produit ni dignité, ni sécurité, ni justice, ni avenir commun ? À quoi bon 1804, si la liberté n’est qu’un mot brandi contre toute tentative d’organisation ? À quoi bon 1804, si le peuple est libre de mourir, libre de fuir, libre de survivre, mais jamais libre de vivre normalement ?
La vérité la plus cruelle est peut-être celle-ci : Haïti ne meurt pas d’avoir été colonisée. Elle meurt d’avoir sacralisé sa rupture sans jamais construire son après. Elle meurt d’avoir confondu mémoire et projet. Mythe et méthode. Révolte et gouvernance.
Pendant ce temps, ailleurs, d’autres peuples réfléchissent calmement à leur avenir collectif. Ils débattent, ils doutent, ils écrivent, ils votent, ils corrigent. Ils savent qu’une liberté qui ne s’incarne pas dans des institutions solides finit toujours par se retourner contre elle-même – et que l’émancipation véritable est un travail de longue haleine, jamais un acquis définitif.
1804 n’était pas une fin. C’était un début. Un point de départ exigeant. Un contrat moral lourd. Il fallait bâtir, transmettre, organiser, protéger. Il fallait transformer la révolte en État, la colère en droit, la victoire en continuité.
Haïti n’a pas trahi l’histoire. Elle s’est trahie elle-même. Non par oubli, mais par illusion. Par la croyance tenace que la liberté, une fois conquise, s’auto-entretient. Par l’idée confortable que l’indépendance est un état naturel, et non une construction politique permanente. Par l’erreur fondamentale qui consiste à penser qu’un peuple libéré est automatiquement un peuple gouverné, structuré, protégé.
Haïti s’est trahie en confondant l’acte fondateur avec l’œuvre à accomplir. En faisant de 1804 une fin symbolique, alors qu’il n’était qu’un commencement brutal, exigeant, presque inhumain par ce qu’il supposait ensuite : bâtir des institutions, transmettre une culture civique, accepter la discipline collective, inscrire la liberté dans des règles durables plutôt que dans des élans héroïques.
Elle s’est trahie en croyant que la souveraineté suffisait à produire la dignité. En oubliant que la liberté n’est viable que lorsqu’elle est organisée, partagée, protégée. Protégée contre l’arbitraire. Protégée contre la prédation des élites. Protégée contre la violence privée qui surgit toujours quand l’autorité publique disparaît.
Elle s’est trahie lorsque la mémoire a remplacé le projet. Lorsque la commémoration a pris la place de la planification. Lorsque l’histoire est devenue un refuge émotionnel plutôt qu’un outil critique. On a appris à réciter 1804, mais pas à l’administrer. À célébrer la rupture, mais pas à construire la continuité. À glorifier la révolte, mais pas à accepter les contraintes nécessaires à la gouvernance. Elle s’est trahie quand la liberté a cessé d’être une responsabilité collective pour devenir un prétexte individuel.
Quand l’État a été perçu comme une menace plutôt que comme une protection.
Quand la loi a été vécue comme une entrave plutôt que comme une garantie.
Quand l’autorité a été assimilée à la tyrannie, et l’organisation au renoncement.
Car une vérité dérangeante traverse toute l’histoire moderne : la liberté qui refuse la règle finit toujours par produire sa propre négation.
Elle se fragmente.
Elle se privatise.
Elle se militarise.
Elle se retourne contre ceux qu’elle prétend défendre.
C’est exactement ce qui s’est produit.
Là où l’État n’a pas tenu, d’autres pouvoirs ont surgi.
Là où la loi s’est retirée, la force s’est installée.
Là où la liberté n’a pas été encadrée, elle est devenue une permission de nuire.
Et l’indépendance, privée d’institutions solides, s’est vidée de sa substance politique. C’est pourquoi la question n’est pas de savoir si Haïti a été injustement traitée par l’histoire, elle l’a été. La question est de savoir ce qu’elle a fait, ensuite, de cette injustice. Et trop souvent, elle a répondu par la répétition, l’improvisation, le provisoire, l’abandon de toute exigence de durée.
La leçon de 1804 n’est donc pas seulement haïtienne. Elle est universelle. Elle dit ceci, avec une clarté presque cruelle : un peuple peut conquérir sa liberté une fois, mais il doit la mériter chaque jour.
La mériter par ses choix institutionnels.
La mériter par sa capacité à transformer l’émotion historique en cadre politique.
La mériter par son refus de confondre souveraineté et désordre.
Sans ce travail quotidien, la liberté se fige.
Elle se mythifie.
Elle se fossilise dans les dates et les discours.
Elle cesse d’être un outil d’émancipation pour devenir une légende commode, invoquée chaque fois que le réel s’effondre.
Et alors, l’indépendance ne disparaît pas brutalement.
Elle s’use.
Elle se vide.
Elle survit sous forme de symbole, tandis que la réalité, elle, s’effrite.
C’est ainsi qu’une victoire historique peut devenir une tragédie contemporaine.
Non par trahison de l’histoire, mais par incapacité à l’habiter pleinement. Sans exigence, la liberté devient un récit. Sans institutions, elle devient une promesse creuse. Et sans courage politique pour la faire durer, l’indépendance n’est plus qu’une date sans lendemain.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.