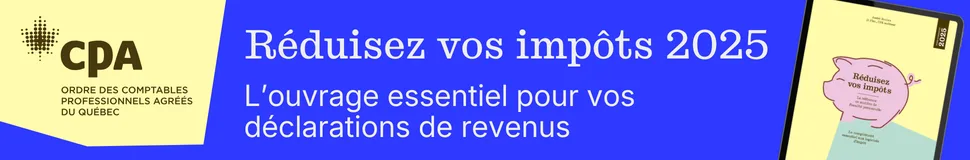Il y a des photographies qui dépassent la simple capture d’un instant. Elles deviennent des miroirs du temps, des rappels silencieux que tout ce qui est aujourd’hui vibrant finira par pâlir, et que nos éclats de rire d’un jour deviendront un écho lointain.
L’une de ces images, devenue légendaire, est celle prise à Harlem en 1958 par Art Kane : cinquante-sept musiciens de jazz réunis, dans leur élégance, un matin trop matinal pour des noctambules habitués à improviser jusqu’au lever du jour.
L’image porte un titre presque prophétique : A Great Day in Harlem. Grande journée, oui. Mais surtout, grande leçon.
Trente-huit ans plus tard, en 1996, Gordon Parks a repris la photo avec les survivants. Et là, une évidence, comme une gifle douce mais implacable : la plupart n’étaient plus là. Certains n’avaient pas eu le temps de vieillir, d’autres avaient quitté ce monde discrètement, comme une note qui s’éteint sans prévenir.
Deux seulement sont encore vivants aujourd’hui : Benny Golson, 95 ans, et Sonny Rollins, 93 ans, l’un présent en 1958 mais absent de la reconstitution de 1996. Ils sont devenus des symboles vivants de ce que le temps laisse derrière lui : quelques survivants, beaucoup d’absents, et un héritage.

La photographie comme miroir de nos vies
Cette photo de Harlem n’est pas seulement une relique pour les amateurs de jazz. Elle est un résumé de notre condition humaine. Dans cinquante ans, nous serons tous cette photo.
Aujourd’hui, nous sourions, nous posons, nous partageons un café, nous envoyons des messages, nous bâtissons des projets. Mais dans cinquante ans ? Pour la plupart d’entre nous, il ne restera qu’un souvenir, une image jaunie peut-être dans un album, une anecdote racontée par un enfant devenu adulte.
Et si l’on regarde bien cette perspective, ce n’est pas une tragédie. C’est simplement la vérité, nue et inévitable. Car, au fond, ce qui compte, ce n’est pas d’échapper à la photo de 2075 où nous ne serons plus. Ce qui compte, c’est ce que nous faisons aujourd’hui, en sachant que la photo viendra.
On dit souvent que le temps file. Mais le temps ne file pas. C’est nous qui filons, courant dans ses mailles, pressés de remplir nos journées de mille choses, comme si en en rajoutant, on pourrait gruger l’inévitable. Le jazz de Harlem nous enseigne autre chose. Ces musiciens savaient que chaque note s’évanouit dans l’air aussitôt qu’elle est jouée. Mais c’est justement parce qu’elle disparaît qu’elle est belle.
Ainsi va la vie : fragile, éphémère, mais splendide quand on la joue sans retenue. Le problème, c’est que nous voulons souvent être éternels. Nous gardons rancunes, nous nous disputons pour des miettes, comme si nous avions 300 ans devant nous.
Mais dans cinquante ans, qui se souviendra de cette dispute ridicule pour une place de stationnement ou pour une assiette mal lavée ? Peut-être même avant cinquante ans, soyons honnêtes.

Apprendre à rire du temps
La philosophie tendre consiste aussi à sourire devant l’inéluctable. Oui, nous vieillirons. Oui, nos cheveux blanchiront, puis tomberont peut-être avant d’avoir blanchi. Oui, notre peau se ridera comme une carte ancienne. Mais au lieu d’en faire une tragédie, pourquoi ne pas en rire ?
Souvenons-nous que le chapeau de Count Basie avait été volé plusieurs fois par des gamins du quartier pendant la séance photo de 1958. Au lieu de s’énerver, Kane, le photographe, les a inclus dans le cliché.
Voilà une sagesse toute simple : transformer le désordre en beauté, inclure ce qui dérange pour en faire mémoire. N’est-ce pas une métaphore parfaite pour nos vies ? On ne maîtrise pas tout. Alors autant rire quand la vie nous vole nos chapeaux.
Dans cinquante ans, nos téléphones si sophistiqués seront sans doute exposés dans un musée comme des antiquités. Nos selfies, multipliés par milliers, feront sourire nos arrière-petits-enfants : « Regarde comme ils aimaient se prendre en photo à chaque repas ! »
Dans cinquante ans, nos noms ne seront peut-être plus prononcés tous les jours, mais peut-être resteront-ils gravés quelque part : dans un texte, une chanson, une photo de famille, un souvenir tendre. Et dans cinquante ans, la question ne sera pas « ont-ils réussi ? » mais « ont-ils aimé ? »
As-tu pris le temps d’écouter tes proches, de serrer des mains, de rire jusqu’aux larmes, de dire merci ? Car le jazz le savait déjà : une note seule ne fait rien. C’est l’accord, la rencontre, l’improvisation collective qui donne un sens.

Leçons pour aujourd’hui
Alors, que faire de cette photo de Harlem ? L’encadrer ? Oui. Mais surtout, la laisser nous parler. Elle nous dit : N’attends pas demain pour appeler quelqu’un que tu aimes. Ne garde pas ton affection en réserve, elle ne rapporte pas d’intérêts. Sois sérieux, mais pas trop. La vie n’est pas un devoir, c’est un jam session.
Nous avons la fâcheuse habitude de vivre comme si nous étions éternels, alors qu’en réalité, nous sommes juste de passage. Et ce passage n’est pas triste. Il est précieux précisément parce qu’il est court. C’est comme un solo de saxophone : il ne dure que quelques mesures, mais il bouleverse.
Quand on regarde les visages de la photo de 1958, il y a une tendresse incroyable. Ces hommes et ces femmes savaient que la musique qu’ils portaient n’était pas seulement des notes. Elle était mémoire, lutte, joie, consolation. C’est peut-être ça, le plus bel héritage : pas des immeubles, pas des fortunes, mais de la tendresse incarnée.
Dans cinquante ans, ce qui restera de nous, ce n’est pas notre compte bancaire (la banque aura déjà changé trois fois de système informatique). Ce n’est pas non plus nos titres, nos diplômes, ou nos querelles. Ce qui restera, ce sont ces gestes de tendresse : un sourire transmis, une main tendue, une parole douce qui a empêché une chute. Comme une mélodie simple, mais inoubliable.

Notre propre « Great Day »
La vie est un peu comme un concert de jazz : elle ne se répète pas. On joue une fois, et c’est tout. Alors, pourquoi ne pas en faire quelque chose de grandiose, ou du moins de joyeux ? Rire de nos maladresses, aimer sans calculer, improviser sans peur du ridicule.
Parce qu’au fond, dans cinquante ans, la plupart d’entre nous ne serons plus là pour corriger nos fausses notes. Mais si nous avons joué avec sincérité, quelqu’un, quelque part, fredonnera encore notre thème.
La photo de Harlem en 1958 s’appelle « A Great Day in Harlem ». Et si aujourd’hui, ici, maintenant, nous décidions que c’était, pour nous aussi, « un grand jour » ? Pas parce qu’il est parfait, mais parce qu’il est là. Parce qu’il nous est donné.
Car dans cinquante ans, il sera trop tard pour se dire qu’on aurait dû rire davantage, aimer plus fort, pardonner plus vite. Faisons-le maintenant, pendant que nous sommes encore debout sur la photo. Et peut-être qu’un jour, quelqu’un nous regardera avec tendresse et se dira : « Ils avaient compris l’essentiel. »
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.