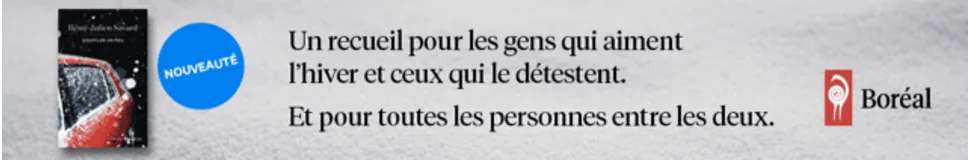J’ai ouvert Instagram comme on pousse la porte d’un appartement qu’on a loué depuis longtemps sans jamais y dormir. Le compte existait, bien rangé, propre, vide. Zéro publication : une chambre blanche. Et puis, l’envie m’a pris d’y déposer des morceaux de route, des visages, des instants. Sauf qu’au moment de choisir… j’ai compris un truc un peu gênant : je possède très peu de clichés récents.
La plus fraîche, la plus officielle, c’est celle qui accompagnera la sortie du roman « C’était ça ou mourir » le 10 mars (merci à François Couture, au passage, pour ce regard qui sait cadrer un auteur sans l’emprisonner dans sa pose). Mais après ça, j’ai dû remonter le fil, comme on remonte un tiroir de mémoire. Et j’ai réalisé qu’il faudrait faire l’inverse de ce que font les réseaux : commencer par les images qui ont déjà eu le temps de devenir sages.
C’est là que je suis retombé sur Paris… Paris !
Pas Paris version carte postale : la tour, la Seine, les clichés en série. Plutôt Paris comme une grande salle de lecture à ciel ouvert : une ville qui aime les phrases longues, les débats tardifs, les idées qui s’installent sur une table et refusent de payer leur part. Paris a ce talent rare : elle donne aux conversations ordinaires une allure de scène. Même une simple soirée peut y prendre l’air d’un chapitre.
Sur la photo, nous sommes quatre. Quatre jeunes Haïtiens, quatre corps qui croient encore que le monde est un texte qu’on peut réécrire à la main : Fabian Charles, Néhémy Dahomey, moi… Thélyson Orélien et Watson Charles (de gauche à droite, sur la photo en vedette). Nous sommes attablés dans un bar/pub, en 2013, au cœur de la ville, avec cette lumière chaude qui rend tout plus vrai qu’en réalité. Sur la table, des verres de bière, presque tous à moitié pleins, signe universel qu’on parlait beaucoup, qu’on buvait doucement, et qu’on n’était pas pressés de devenir adultes.

Je regarde cette image et je ris tout seul : on dirait une confrérie improvisée, une société secrète de jeunes auteurs, dont le mot de passe aurait été « on verra bien ». À gauche, un sourire large, le genre de sourire qui ignore encore l’administration, les factures et les phrases qu’on doit “raccourcir”. À droite, un regard plus posé, déjà conscient que la vie aime contredire les plans. Et au milieu, cette énergie collective : on n’était pas riches, mais on se sentait riches de possibles.
Ce qui me touche, avec ces photos d’hier, c’est qu’elles n’ont pas besoin de se vendre. Elles ne cherchent pas l’effet. Elles ne font pas la maligne. Elles ne demandent pas un filtre pour prouver qu’elles ont existé. Elles arrivent avec leur grain, leur lumière imparfaite, leurs détails qui trahissent l’époque, et elles gagnent. Elles disent : « Voilà. C’était nous. C’était vrai. »
Paris, ce soir-là, jouait son rôle préféré : celui de la ville qui écoute. J’avais quitté Montréal, cette autre capitale de la conversation, mais avec un accent de neige et de rue, pour venir se frotter à l’ancienne dame brillante, la grande librairie vivante. Et forcément, on parlait de littérature : de nos écrivains fétiches, de nos colères, de nos admirations, de ce qu’on voulait sauver du monde et de ce qu’on voulait gifler du bout d’un paragraphe.
À Paris, parler de livres ressemble presque à une activité sportive : on s’échauffe, on s’interrompt, on cite, on s’emporte, puis on recommence. La ville a cette élégance : elle autorise le sérieux sans le rendre ennuyeux. Elle permet de discuter “société” sans avoir l’air de faire un exposé. Même quand on se trompe, on se trompe avec style. Les rues semblent dire : « Vas-y, pense. Ici, on respecte ça. »
Mais je veux aussi que le lecteur du Québec se reconnaisse dans cette scène, parce qu’au fond, cette photo est un pont. Montréal n’a pas besoin de l’autorisation de Paris pour exister, et Paris n’a pas besoin de Montréal pour briller : pourtant, les deux villes se comprennent. Elles aiment les cafés où l’on refait le monde, elles aiment les gens qui écrivent sans garantie, elles aiment les histoires qui viennent d’ailleurs et qui finissent par devenir d’ici. Montréal m’a appris le mélange, l’écoute, l’ironie douce. Paris m’a rappelé la tradition, la densité, le goût de la phrase qui ose. Entre les deux, on avance, on se cherche, on s’éduque.
Et puis, il y a nous : quatre jeunes Haïtiens, dans une ville qui a ses propres mythes, portant nos propres mythes dans nos poches. On n’avait pas seulement des projets; on avait une faim. Pas une faim de réussite facile. Une faim de sens. Une faim de beauté. Une faim de dignité. La diaspora, ce n’est pas juste un mot de conférence : c’est une façon d’apprendre à tenir debout avec plusieurs ailleurs à l’intérieur de soi.
Quand je revois cette image, je pense à ce qui a changé, et à ce qui demeure. Les visages ont mûri, les chemins se sont séparés, les certitudes ont perdu leur arrogance. On a appris que le monde se conquiert rarement comme on l’imagine à vingt ans : il se traverse, il se négocie, il se paie en patience. Mais il reste, dans nos regards, cette chose intacte : l’envie de dire vrai, l’envie de dire beau, l’envie de faire mieux, l’envie d’être fidèle à ce qu’on a promis sans même s’en rendre compte.
C’est ça, la force des vieilles images : elles ne donnent pas des leçons, elles rappellent. Elles te prennent par l’épaule et te soufflent : « Tu vois ? Tu as déjà été capable d’y croire. » Elles rendent à la mémoire sa fonction la plus noble : non pas pleurer le passé, mais lui emprunter du courage.
Alors oui, je vais commencer Instagram à rebours. Je vais poster d’abord les photos qui ont eu le temps de devenir profondes. Je vais publier les souvenirs avant les “news”. Parce que, paradoxalement, c’est ce qui est ancien qui paraît le plus neuf : une époque où l’on n’avait pas besoin de prouver qu’on vivait, où l’on vivait, et puis c’est tout.
Et cette photo de 2013, dans un bar/pub parisien, restera comme un petit serment silencieux : quatre jeunes écrivains haïtiens, un peu trop confiants, un peu trop heureux, en train de fabriquer, sans le savoir, une réserve de lumière pour les années plus exigeantes.
Le reste viendra. Les images de mars, la sortie du roman, les sourires d’aujourd’hui. Mais d’abord, je rends hommage à ces instants où l’on ne posait pas pour l’avenir : on le préparait, simplement, en parlant jusqu’à la dernière gorgée.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.