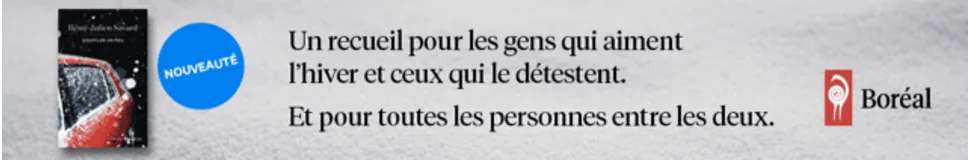« Encore un jour à se lever / En même temps que le soleil… »*, chantent quelque part des camionneurs au cœur usé, la voix pleine de routes trop longues. Et pendant que résonnent ces paroles fatiguées, cette Amérique qui pleure dans un vieux rétroviseur ressemble étrangement à celle qui décrète froidement qu’un peuple entier n’aura pas de visas. « Y a tellement d’inégalités / Et de souffrance sur les visages… »* On dirait que ces lignes des Cowboys Fringants ont été écrites pour Haïti et les Haïtiens. Pour l’absurdité du monde. Pour ce théâtre où rigolent les puissants pendant que les petites nations se battent avec des mains nues.
C’est une histoire simple, vraiment. Une petite histoire de rien du tout, comme on en lit chaque semaine dans le grand théâtre absurde de la politique internationale : un pays appauvri, cabossé, malmené par l’Histoire, parvient à qualifier son équipe nationale de football pour la Coupe du monde… et un autre pays, immensément riche, doté d’un ego mondial soutenu par une armée et un appareil médiatique tentaculaire, décide que les supporters de ce petit pays ne mettront pas un orteil sur son territoire. C’est presque poétique, en un sens : une parabole moderne sur le pouvoir, la peur, et la manière dont certains gouvernants transforment leurs obsessions personnelles en doctrine d’État. On en rirait, si ce n’était pas précisément le rire nerveux de ceux qui comprennent trop bien le procédé.
Car il faut dire les choses franchement : depuis près d’une décennie, il existe une étrange tradition consistant à faire de quelques millions d’Haïtiens le réceptacle idéal des angoisses nationales d’un certain leader américain. Une sorte de défouloir politique commode, un punching-ball diplomatique sur lequel on peut frapper sans que les grands discours sur les droits humains viennent trop perturber la mise en scène. Le problème, c’est que cette tradition a pris, au fil des années, l’allure d’un feuilleton où les épisodes rivalisent de créativité dans la caricature.
Tout commence un soir de 2017, dans une salle de réunion de la Maison-Blanche, où un dirigeant exaspéré — déjà en mode émission de téléréalité permanente — s’agace que quinze mille Haïtiens aient obtenu un visa pour les États-Unis. Il lâche alors, selon plusieurs témoins, cette phrase immortelle : “They all have AIDS.” Le genre de formule qui ouvre l’appétit dans un banquet diplomatique. L’idée qu’un peuple entier puisse être réduit à une maladie, c’est vieux comme les pestiférés du Moyen Âge, mais il fallait du talent pour l’importer dans le XXIᵉ siècle avec un tel naturel.
Mais l’histoire s’étoffe. L’année suivante, autre réunion, autre éclair de génie verbal : Haïti est désormais rangé dans la catégorie des “shithole countries”. L’expression fait scandale. On joue les vierges effarouchées dans les talk-shows, on débat, on proteste, on dénonce. Mais au fond, l’homme n’a fait que dire tout haut ce que sa politique migratoire murmurait déjà.
Pendant ce temps, dans les rues de Port-au-Prince, les Haïtiens continuent à faire exactement ce qu’ils font depuis deux siècles : survivre à tout, même à ceux qui les prennent pour des pays de seconde zone. Et comme si la réalité ne suffisait pas, on leur ajoute une couche d’imaginaire. En 2024, lors d’un débat présidentiel, surgit l’accusation spectaculaire : des migrants haïtiens, dans une ville de l’Ohio, mangeraient les chats et les chiens des habitants. Une histoire tellement grotesque que même les services de police locaux — pourtant peu connus pour leur sens de la poésie — se sont empressés de la démentir. Mais la rumeur, comme toutes les rumeurs construites pour déshumaniser un groupe, persiste.
« La question qu’j’me pose tout l’temps
Mais comment font tous ces gens
Pour croire encore en la vie
Dans cette hypocrisie? »*.
Voilà. Tout est là. L’hypocrisie : moteur du monde, carburant des discours, et rideau de fumée idéal pour les exclusions organisées. Car c’est une vieille technique : avant d’exclure, avant de bannir, avant de priver un peuple de droits fondamentaux, on commence par lui coller des attributs monstrueux, irrationnels, bestiaux. Un procédé ancien, utilisé ailleurs, autrefois, pour fabriquer des ennemis intérieurs. On accuse, on invente, on amplifie jusqu’à ce que la population accepte l’inhumanité comme un fait.
C’est ici qu’entre en scène la partie la plus ironique du récit. À force d’être décrits comme dangereux, incontrôlables, ingérables, voilà que les Haïtiens deviennent littéralement indésirables aux frontières. En 2025, une proclamation présidentielle instaure un travel ban visant Haïti. Les visas sont suspendus, les portes se ferment, et les discours officiels justifient tout cela par des taux d’“overstay”, de supposées infiltrations criminelles, ou autres catégories inventées pour éviter de dire tout haut ce que tout le monde comprend : les Haïtiens ne sont pas bienvenus, ni maintenant, ni plus tard… Et c’est ici que l’absurdité devient mathématique : on nous dit “passons à autre chose”, comme s’il suffisait de détourner le regard pour que l’injustice perde sa couleur. Mais comment voulez-vous passer à autre chose quand la majorité des pays interdits d’accès aux États-Unis ont une seule chose en commun : la couleur de leur population? Quand la liste ressemble à une leçon de géographie coloniale — Haïti, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Djibouti, Éthiopie, Égypte, Gabon, Gambie, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. Comment “passer à autre chose” quand ce n’est plus un hasard, mais un motif, un motif tellement visible qu’il crie tout seul dans le silence diplomatique?
Et pourtant… l’histoire adore les retournements. Novembre 2025 : Haïti, ce petit pays shithole selon les termes d’un certain homme, se qualifie pour la Coupe du monde. La deuxième participation de son histoire, depuis 1974. Un exploit national. Une explosion de joie. Une manière de rappeler au monde que même les peuples qu’on traite avec condescendance savent produire des miracles. Dans les rues, des enfants courent avec des drapeaux, des familles prient, des villages entiers célèbrent. Une victoire qui n’est pas seulement sportive, mais symbolique : une revanche sur la fatalité, une preuve que l’espoir n’est jamais totalement mort.
Mais la Coupe du monde se déroule… en Amérique du Nord. Sur le territoire même du pays qui interdit désormais l’accès aux Haïtiens. Aucun visa pour les supporters, aucune dérogation, aucune humanité administrative.
« Pis que j’parke mon vieux camion
J’vois toute l’Amérique qui pleure
Dans mon rétroviseur… »*
Oui. Parce que derrière ce rideau de force et de loi, ce qu’on voit vraiment, c’est un pays qui pleure sa propre peur, sa propre fragilité, sa propre incapacité à accueillir l’autre autrement que par la suspicion.
Et pendant que les frontières se ferment, les joueurs haïtiens, eux, s’entraînent sur des terrains parfois transformés en camps improvisés, encerclés par l’insécurité, les balles perdues, les gangs armés. Ils jonglent avec des ballons sur des sols où, la veille encore, des familles fuyaient pour survivre. Ils courent dans des quartiers où les armes — venues précisément du pays qui leur refuse aujourd’hui l’entrée — circulent plus librement que l’eau potable.
La résistance de ces joueurs est un acte politique. Un acte de vie. Un pied de nez à la fatalité. Là où d’autres équipes travaillent dans des centres technologiques ultramodernes, eux avancent dans le fracas du chaos. Ils n’ont pas seulement gagné des matchs : ils ont défié la logique du désespoir.
Et pendant qu’ils luttent, le monde entier regarde, silencieux, avec ce calme confortable de ceux qui observent une tragédie lointaine comme on regarde une série Netflix. « Pendant qu’les vœux pieux passent dans l’beurre / Que notre insouciance est repue… »* Oui. L’insouciance du monde est repue, gavée, indifférente. « C’est dans le fond des containers / Que pourront pourrir les surplus.»* Et dans le fond des quartiers abandonnés, ce sont des vies humaines qui pourrissent aussi.
On a déjà vu cela, ailleurs, dans d’autres époques : un groupe désigné comme problème public, pointé du doigt, caricaturé, exclu progressivement, pendant que le reste du monde détourne la tête. Le procédé est le même, le décor change, les victimes changent, mais la mécanique reste identique. Mais malgré tout, Haïti continue de fabriquer de la vie là où tout semble vouloir la tuer. Les joueurs haïtiens, en se qualifiant pour la Coupe du monde, rappellent que la dignité n’a pas besoin d’un visa. Ils rappellent que le courage ne dépend pas des frontières.
« Ouais, n’empêche que moi aussi / Quand j’roule tout seul dans la nuit / J’me demande des fois c’que j’fous ici… »* C’est exactement la question que se posent des millions d’Haïtiens : qu’est-ce qu’on fait encore ici, dans ce monde qui nous ferme les portes? Et pourtant, ils sont là.
« La question qu’j’me pose tout le temps / Pourquoi travailler autant / Éloigné de ceux que j’aime / Tout ça pour jouer la game? »* Les joueurs haïtiens, eux aussi, jouent la game, mais pas celle des puissants. Celle de la survie. Celle de la dignité. Celle de l’amour d’un pays que le monde préfère oublier. Les peuples qu’on dénigre, qu’on insulte et qu’on caricature finissent toujours par réapparaître dans l’Histoire, brandissant un drapeau, un poing, une chanson, un but marqué dans un stade interdit. Et il arrivera peut-être un jour où, dans un stade rempli d’autres nations, quelqu’un se lèvera, brandira un drapeau haïtien et criera : « Nou la toujou ! » (Nous sommes encore là.)
Et cela, aucune frontière, aucun décret, aucune obsession politique ne pourra l’empêcher. Parce que, finalement, « J’ai toute l’Amérique qui pleure / Queq’ part au fond du cœur. »* Et c’est là, peut-être, le vrai drame de notre époque : si l’Amérique pleure, ce n’est pas seulement parce que les routes sont longues, les villes brisées ou les rêves en feu. Elle pleure parce que le monde entier lui ressemble de plus en plus. Elle pleure parce que chacun de nous, sur son propre continent, a fini par croire qu’il suffit de se protéger pour vivre mieux, alors que la seule chose qui nous protège encore, c’est ce fragile filament d’humanité que nous partageons tous.
Elle pleure parce que ce qu’on refuse de voir chez les autres, c’est exactement ce que nous redoutons de découvrir en nous-mêmes : notre peur, notre solitude, notre incapacité à aimer plus large que notre ombre.
Elle pleure parce que les enfants de Port-au-Prince, de Québec, de New York, de Bamako, de Port-of-Spain ou de Marseille grandiront dans le même monde, et que si l’un d’eux tombe, il emporte un morceau de nous tous.
Et si un simple match de football, une chanson triste ou un drapeau levé par un inconnu peut encore nous rappeler cela, alors il n’est peut-être pas trop tard. Pas trop tard pour comprendre que la grandeur d’un peuple ne réside jamais dans sa force, mais dans sa capacité à ne pas détourner les yeux quand quelqu’un souffre. Pas trop tard pour comprendre que lorsqu’un pays pleure, ce n’est jamais seulement lui : c’est le monde entier qui pleure à travers lui.
Et que si l’Amérique pleure aujourd’hui, c’est parce que nous pleurons tous — mais trop souvent, en silence. Un jour peut-être, ce silence se brisera. Et ce jour-là, les larmes de l’Amérique ne seront plus un écho triste dans un rétroviseur, mais le premier signe que l’humanité recommence enfin à se regarder en face.
* Crédit : extraits de la chanson L’Amérique pleure, interprétée et écrite par Les Cowboys Fringants.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.