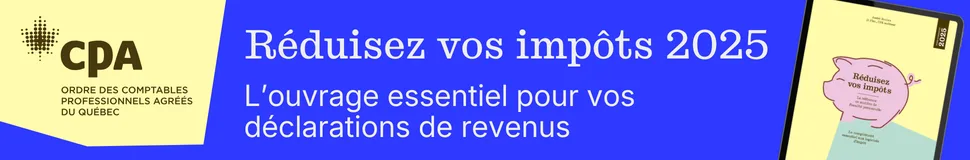Je n’aime pas la fête des Guédés. Voilà, c’est dit. Dans un pays où tout le monde prétend aimer ce qu’il ne comprend plus, où l’on appelle culture ce qui relève souvent de la transe collective, je préfère dire ce que beaucoup pensent tout bas : cette fête n’est plus une célébration de la mort, mais une profanation du vivant.
Le 1er et 2 novembre, Port-au-Prince se transforme en théâtre grotesque. On appelle cela “rendre hommage aux morts”. En réalité, c’est un spectacle public où la mort, lasse d’être vénérée, se cache sous les rires gras. Des foules entières envahissent les cimetières, poudre blanche au visage, lunettes à l’envers, bouteilles de clairin à la main. Et devant la croix de Baron Samedi — le maître des lieux — c’est une scène dantesque : cris, insultes, obscénités, orgie d’alcool et de symboles.
On dit que c’est la “spiritualité du peuple”. J’y vois une mise en scène macabre de l’aliénation. On ne célèbre plus, on performe. On ne médite plus sur la mort, on la travestit. Le cimetière devient un chapiteau, la tombe un bar, la croix un décor. Et au milieu de tout cela, Baron Samedi, incarnation du passage entre la vie et la mort, réduit à une figure de carnaval : un comédien, un clown vaudou.
Dans la logique du Guédé, tout est inversé : le sacré devient spectacle, le recueillement devient vacarme. On se déguise pour invoquer les morts, on rit pour conjurer la peur, on boit pour “communiquer”. Ce n’est plus une foi, c’est une fuite. Une religion qui, faute d’avoir su évoluer, s’est réfugiée dans la gesticulation.
La philosophie du Guédé se fonde sur une vérité : celui qui a connu la mort n’a plus peur de rien. Mais en Haïti, cette sagesse s’est transformée en excuse pour justifier la décadence. L’homme “qui ne craint plus rien” devient celui qui n’a plus de pudeur. La liberté spirituelle s’est muée en impudeur collective. Quand des hommes s’enduisent les parties intimes de piment devant des enfants, quand la vulgarité devient rite, le sacré a déjà quitté les lieux.
C’est cela, l’aliénation suprême : confondre liberté et déchéance, spiritualité et exhibitionnisme.
Depuis quelques années, les élites et les “ambassadeurs de la culture haïtienne” adorent montrer les Guédés au monde. C’est folklorique, c’est “authentique”. Les photographes étrangers s’en donnent à cœur joie : les visages blanchis, les danseurs, les bouteilles, les croix. Tout cela fait de belles images pour les magazines. Une Haïti pittoresque, exotique, noire et mystique.
Mais qu’y a-t-il derrière ces clichés ? Une souffrance recyclée en divertissement. Une foi populaire instrumentalisée. Une misère qui se maquille pour être montrée.
On appelle cela la “promotion de la culture”. Moi, j’appelle cela la propagande du désordre. Car si la culture est ce qui élève, alors ce spectacle, lui, abaisse. Il abaisse l’esprit au niveau de la transe. Il remplace la réflexion par la possession. Il fait de la mort un prétexte à la danse et de la foi un prétexte à l’oubli.
Le Guédé, au départ, n’est pas une erreur. C’est un miroir. Un miroir de notre rapport à la mort, au rire, au chaos. Les Haïtiens ont toujours eu cette force : rire de la mort pour ne pas en mourir. Mais quand le rire devient un cri d’ivresse, ce n’est plus de la philosophie, c’est du désespoir.
Il faut bien comprendre : la fête des morts, dans d’autres cultures, est empreinte de silence et de respect. En Haïti, on a confondu le courage avec le vacarme. Comme si la dignité devait se mesurer au volume du tambour. Comme si l’esprit des ancêtres se nourrissait d’obscénités et de clairin.
La mort n’a pas besoin d’alcool pour se faire entendre. Elle parle déjà assez fort dans les rues, dans les hôpitaux, dans les commissariats, dans les maisons sans toit. Et voilà qu’on l’invite à boire encore, à rire encore. Le peuple, pris dans sa misère, croit communier. En vérité, il s’oublie.
L’aliénation n’est pas seulement politique ou économique. Elle est aussi spirituelle. Quand une société transforme la mort en carnaval, c’est qu’elle ne sait plus comment parler de la vie. Quand la religion devient théâtre, c’est que l’espérance a disparu.
Le Guédé, c’est la version mystique de notre désarroi : on danse sur les tombes parce qu’on n’a plus de place pour rêver ailleurs. On prie des esprits parce qu’on ne croit plus aux institutions. On verse du rhum sur la croix parce qu’on ne verse plus de sens dans nos vies. Et pourtant, il y a dans cette folie quelque chose de grandiose : un peuple qui refuse le silence. Mais la grandeur ne suffit pas à excuser la laideur.
Les défenseurs du Guédé parlent de “syncrétisme religieux” : un mariage entre le catholicisme et le vodou. Je veux bien. Mais un mariage ne fonctionne pas quand les conjoints s’insultent. Les 1er et 2 novembre, dates qui correspondent dans le calendrier catholique à la Toussaint et à la Commémoration des fidèles défunts — la “fête des morts” —, auraient pu être un moment de recueillement partagé, un temps de convergence spirituelle entre deux visions du sacré : celle du cimetière comme lieu de silence et celle du cimetière comme espace de transe.
Pourtant, au lieu de communion, c’est souvent la confusion. Comment parler de fusion spirituelle quand on profère des obscénités devant une croix ? Comment parler d’hommage quand on tourne la mort en spectacle ?
On dit que “les esprits aiment la joie”. Peut-être. Mais la joie n’a jamais eu besoin de vulgarité pour exister. Le rire n’a pas besoin de piment ni d’entrejambe pour être sincère. Ce que nous appelons spiritualité populaire ressemble de plus en plus à une caricature. C’est cela, le drame : à force de défendre “la culture”, on a cessé de la questionner. À force de célébrer nos traditions, on a oublié de les élever.
Comme le disait Albert Camus : “Toute religion finit par justifier ce qu’elle voulait combattre.” J’adhère à cette lucidité. La religion, quelle qu’elle soit, n’est jamais totalement objective ; elle est le miroir des besoins humains, de nos peurs et de nos illusions. Elle prétend sauver l’homme, mais parfois, elle l’endort. C’est là que réside le danger : lorsque la foi devient une habitude culturelle plutôt qu’une quête de vérité. Je n’ai rien contre le vodou. Je crois même qu’il fait partie du génie haïtien : une forme d’intelligence spirituelle née de la résistance. Mais je refuse de confondre la foi avec la farce. Il y a une dignité à préserver, même dans la dévotion.
Les morts méritent mieux que des insultes. Les ancêtres méritent mieux que des gestes obscènes. Le Baron Samedi mérite mieux que des imitations grotesques. Si nous croyons vraiment à ces esprits, pourquoi les traiterions-nous comme des clowns ? Vénérer, oui. Mais avec dignité.
Objectivement, peut-on dire qu’une religion est la culture d’un peuple ? C’est une question que les sociologues et les philosophes se posent depuis Durkheim. La religion, selon lui, est “un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées” — c’est-à-dire un langage symbolique qui structure le lien social. Mais la culture, elle, est mouvante ; elle inclut le savoir, les mœurs, les arts, la mémoire collective.
Une religion peut donc influencer la culture, mais elle ne saurait s’y confondre. Le danger apparaît lorsque la foi devient folklore et que les pratiques sacrées se réduisent à des gestes identitaires. Le vodou, dans sa profondeur, est une spiritualité née du traumatisme, un cri de liberté pendant l’esclavage. Mais lorsque l’on répète sans comprendre, quand l’on danse sans méditer, quand le rite devient routine, ce n’est plus une religion : c’est un souvenir vidé de sens.
Mon ami — un bon vivant un peu fou — me dit souvent que le vodou est la culture haïtienne. Je lui réponds que c’est faux. Le vodou fait partie de la culture, mais il ne la résume pas. Haïti, ce n’est pas que des loas ; c’est aussi des écrivains, des penseurs, des savants, des ouvriers, des mères qui prient sans tambour ni piment. Réduire notre culture au vodou, c’est enfermer notre imaginaire dans un enclos mystique. C’est comme si la France se définissait uniquement par la messe ou l’Italie par le Vatican.
La culture d’un peuple, c’est sa capacité à se dépasser, à transformer ses croyances en conscience. Une religion peut nourrir la culture, mais lorsqu’elle se fait culture elle-même, elle cesse d’éclairer ; elle devient idéologie, ou pire : spectacle.
Ceux qui adorent Baron Criminel, Baron Cimetière ou encore Baron Lacroix diraient que je blasphème. Mais ces figures, censées incarner le passage, sont devenues des symboles de violence. Baron Criminel, notamment, est invoqué pour la vengeance ; il aime, dit-on, le sang, les insultes et les flammes. On le décrit armé, ricanant, prêt à brûler quiconque l’offense. Comment appeler cela spiritualité ?
Les fanatiques de ces loas brandissent la peur comme autorité. Ils se disent “initiés”, mais ne propagent que la terreur mystique. Ils confondent puissance et menace. Et dans les quartiers, certains se font justiciers de l’au-delà, croyant servir Baron Criminel ou Marinette Bois-Chèche. C’est là que le vodou cesse d’être foi ; il devient superstitieux, presque mafieux.
La religion n’est jamais plus dangereuse que lorsqu’elle se croit au-dessus de la raison. Quand elle cesse d’interroger le bien pour n’obéir qu’à la peur. Le vodou, dans ses excès, reproduit les travers de toutes les religions fanatisées : l’orgueil de croire qu’on détient la vérité, et le plaisir d’humilier ceux qui doutent.
Aujourd’hui, tout se vend. Même la mort. On tourne des documentaires, on vend des t-shirts “Guédé Spirit”, on fait du marketing mystique. La foi devient un produit touristique. Les esprits deviennent des marques. Et pendant qu’on glorifie la “richesse de notre culture”, nos hôpitaux manquent de médecins, nos écoles de professeurs, nos rues de justice. Le Guédé, autrefois rite de mémoire, est devenu la foire du simulacre. Et cette foire, on l’appelle “fierté nationale”.
Je ne suis pas de ceux qui méprisent leur culture. Je dis simplement que la culture doit élever, pas rabaisser. Quand elle se réduit à des gestes grotesques, elle devient propagande : celle d’un peuple enfermé dans son folklore, applaudi pour son exotisme, jamais respecté pour sa pensée. Les Guédés ne sont pas le problème. C’est notre façon de les célébrer. Ce que nous appelons “tradition” est devenu un réflexe pavlovien : répéter sans comprendre, crier sans écouter, danser sans sentir. Un peuple peut vénérer ses morts sans les travestir. Il peut croire aux esprits sans renoncer à la décence. Il peut chanter la vie sans profaner la mort.
Je ne suis pas un croyant, seulement un témoin lucide d’un peuple qui danse au bord de ses tombes. Mon esprit ne s’incline devant aucun autel, ni visible ni invisible ; je regarde les dieux comme on regarde des miroirs vides, des inventions nécessaires à ceux qui ont peur du silence. Il n’est point de ciel où je cherche refuge, ni de nom que je murmure quand tout vacille. Ce que je ressens, ce n’est pas de la peur, mais une immense tristesse.
Je n’aime pas les Guédés. Pas parce qu’ils me font peur, ni parce que je crois aux esprits — je n’en suis pas un adepte, ni un initié. Je ne suis pas un croyant, seulement un témoin lucide d’un peuple qui danse au bord de ses tombes. Ce que je ressens, ce n’est pas de la peur, mais une immense tristesse.
Derrière les rires et le rhum, j’y vois un peuple qui cherche sa dignité dans la poussière des sépultures. Une nation qui, au lieu de parler à ses morts, leur crie son désespoir. Et cette voix, au fond, ne vient pas du cimetière : elle monte de notre impuissance à nous relever vivants.
Et si, pour une fois, on décidait de fêter la mort autrement ?
En silence. En respect. En conscience.
Ce serait peut-être le plus beau des miracles.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.