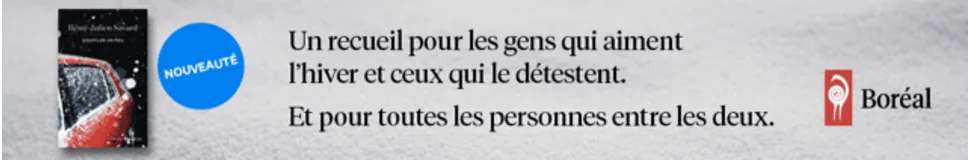Je n’aime pas particulièrement les samedis soirs.
C’est une opinion que je partage avec mon lave-vaisselle, qui s’obstine à tomber en panne le samedi soir. Et avec mon fils cadet, qui préfère les dimanches matin – parce qu’on mange des crêpes, pas parce qu’il aime les matins. Moi, les samedis soirs, je les trouve lourds de promesses mal tenues. Trop de bruit. Trop de gens. Trop de matchs de foot à sens unique.
Mais ce samedi-là, le 2 août, il s’est passé quelque chose.
Pas un miracle. Non. Un événement. Un vrai. De ceux qui font lever le menton, qui donnent envie de se rasseoir correctement sur son canapé, qui te font oublier que tu venais juste de dire à voix haute : « Le tennis féminin, c’est plus ce que c’était ».
À 18 ans à peine, une jeune fille nommée Victoria Mboko a renversé la hiérarchie. Et quand je dis renversé, je parle de ce genre de renversement que même les meilleurs chiropraticiens du monde déconseillent.
Coco Gauff. Numéro deux mondiale. Championne, médiatisée, adoubée, adulée. L’Américaine qu’on n’a plus besoin de présenter, et que les projecteurs suivent même quand elle va chercher un latté.
Et là, arrive Mboko. J’Mboko, comme je l’appelle désormais affectueusement. Parce que cette fille-là joue comme si elle disait au monde entier : « J’y vais. J’y crois. J’Mboko. »
L’élégance des météores
Il y a quelque chose d’élégamment insolent dans sa manière de frapper la balle. Elle ne cogne pas, elle cisèle. Ce n’est pas une brute de puissance, c’est une chirurgienne de la ligne de fond. Ses revers sont des traits d’ardoise bien nets, ses montées au filet, des ruses de funambule.
Elle ne joue pas seulement contre Coco Gauff. Elle joue contre les attentes. Contre l’habitude de voir les matchs déjà gagnés avant d’être joués. Elle joue contre l’idée que le tennis canadien ne produit qu’un feu follet tous les dix ans. Elle joue pour nous rappeler qu’on peut venir d’ailleurs, s’installer ici, apprendre ici, rêver ici, et gagner ici.
Mboko, c’est le genre d’histoire que même les scénaristes de Netflix trouveraient trop belle pour être vraie.
Née en Caroline du Nord de parents congolais, élevée dans la grande banlieue torontoise, entraînée par les meilleurs du pays, puis expédiée à 12 ans en Floride comme une future rock star de la raquette. Là-bas, l’IMG Academy, la Mecque des talents. Un passage par la Belgique ensuite, chez l’ancienne numéro un mondiale Justine Henin, rien de moins. Et aujourd’hui, la voilà, samedi soir, devant des milliers de spectateurs, avec le drapeau du Canada cousu au cœur.
Qu’on me pardonne mon chauvinisme
Soyons clairs : ce n’est pas parce qu’elle joue pour le Canada que je me suis mis à crier comme un adolescent qui découvre Céline Dion à 2h du matin. Non. Ce n’est pas que ça.
C’est que cette fille joue avec la fougue des origines et l’intelligence des grandes. C’est qu’elle a compris ce que très peu comprennent si jeunes : le tennis, ce n’est pas qu’une affaire de bras. C’est une affaire de nerfs.
Et samedi, à Montréal, en huitièmes de finale de l’Omnium de tennis Banque Nationale, ses nerfs étaient faits de titane et d’orchidées.
6-1, 6-4. Voilà le score. Net, sans bavure. Un samedi soir qui fait mentir mon pessimisme. Je ne sais pas si je dois remercier Victoria ou mon lave-vaisselle pour cette soirée parfaite.
Les étoiles noires brillent aussi
Au moment où j’écris ces lignes, elle est en quart de finale. Seule représentante canadienne encore debout, femmes et hommes confondus. Je pourrais faire semblant d’être surpris, mais je ne le suis pas. Cette fille a une fiche de 46 victoires et seulement 9 défaites cette saison. Elle remonte le classement comme une fusée inverse la gravité : naturellement.
266 places gagnées en un an. Vous imaginez ? Si mon ami Lolo gagnait 266 amis en un an, il fermerait Facebook par peur du monde. Elle, elle grimpe, tranquille, avec ses dreadlocks sages et son regard qui dit : « Je vous avais prévenus. »
Il faut aussi parler de ce que cette victoire signifie au-delà du court.
Mboko est une jeune femme noire, francophone, née d’immigrants africains, formée au Canada. Elle renverse des icônes dans un sport longtemps réservé à une élite trop blanche, trop lisse, trop serrée dans ses polos.
Elle est la preuve, si on en avait encore besoin, que le talent n’a pas de couleur, que la grâce n’a pas de pays, et que la discipline peut pousser partout, même dans un coin de Toronto où l’hiver se mêle parfois à la pauvreté.
Mboko, c’est l’espoir d’une autre histoire. Une histoire où les petites filles qui regardent le tennis à la télé ne demandent plus pourquoi aucune joueuse ne leur ressemble. Une histoire où la diversité ne se dit pas, elle se vit, raquette en main.
J’Mboko, tu sais…
J’ai repensé à son prénom : Victoria. Ce n’est pas juste un nom de reine, c’est une promesse. Une prophétie. Je me suis dit que ses parents avaient dû ressentir quelque chose, ce jour-là, à la maternité. Une intuition.
Ce prénom, elle l’incarne. Elle ne le porte pas comme un poids, mais comme une invitation. « Je suis la victoire, regardez-moi. »
Et on la regarde. Parce que c’est beau à voir. Parce que ça nous change de la résignation. Parce qu’on en avait besoin, de cette claque sportive-là. Une claque donnée avec le sourire, avec classe, avec un poignet de velours et des mollets d’acier.
La suite ? On verra. Le tennis est un sport cruel. Il ne suffit pas de gagner une fois. Il faut se réinventer à chaque match. Il faut être prête à perdre, à douter, à se relever.
Mais quoi qu’il advienne, Victoria Mboko a déjà gagné quelque chose que personne ne pourra lui enlever : notre admiration. Et aussi, avouons-le, notre espoir que le Canada ait enfin trouvé sa prochaine grande.
Peut-être que dans dix ans, quand on parlera d’elle dans les manuels de sport, on dira : Elle a commencé un samedi soir de 2025, par un 6-1, 6-4.
Et moi, je sourirai en repensant à cette chronique, à mon lave-vaisselle, et à ce samedi pas comme les autres.
Parce que ce soir-là, J’Mboko.
Et vous aussi, je parie.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.