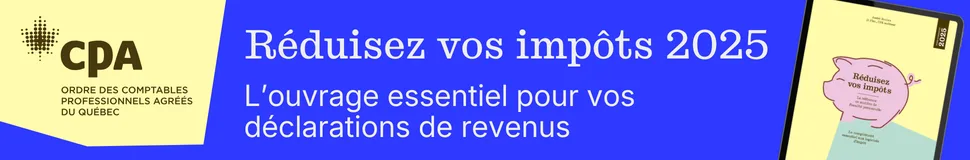L’autre soir, j’ai écrit à Samuel. Samuel Dauphin, le poète, resté là-bas, en Haïti. Tu sais, ce genre d’ami qu’on a tous un peu, quelque part, un gardien de mémoire, celui à qui on confie les choses qu’on ne dit pas tout haut. Ce n’était rien de solennel, juste quelques mots, comme une bouteille lancée à la mer. Je lui ai glissé que je voulais enfin m’y mettre, à cette histoire qui me trotte dans la tête depuis des années. Lui seul en connaît les replis, les parts cachées, celles qu’on murmure plus qu’on ne les raconte. Pas en historien, non. Plutôt comme on raconte une histoire de famille, de gens. Une histoire parfois lourde, souvent tue, mais traversée malgré tout par une beauté qui résiste. Et en écrivant ces lignes, j’ai senti ce vieux projet se rallumer doucement, comme une braise qu’on croyait éteinte.
Cela fait près de dix ans que j’essaie de lui donner une forme, sans encore parvenir à l’achever. J’y reviens, je m’en éloigne, je fais des détours. Écrire, quand on veut être juste, c’est lent et solitaire. On s’assoit, on avance, et puis on se heurte à ce mur invisible : l’énergie qui flanche, le souffle qui manque, les mots qui ne viennent plus. Et quand je sens que je n’ai plus de carburant pour entrer vraiment dans un texte, je préfère m’arrêter, pour ne pas gâcher la page. Ce n’est pas de la paresse, c’est une forme de respect. Envers le sujet, et envers la phrase elle-même.
C’est avec cet état d’esprit que j’ai ouvert Ça finit quand, toujours ? d’Agnès Gruda, et que quelque chose s’est remis à battre en moi. Il y a des romans qui ne font pas que raconter une histoire : ils ouvrent une fenêtre, puis une autre, et encore une autre, jusqu’à ce que tu te retrouves dans une maison entière, avec ses couloirs, ses odeurs, ses verres sur la table, ses silences, ses disputes, ses fêtes improvisées, et surtout, ses absents. Ça finit quand, toujours ? est de cette trempe : une grande saga familiale et amicale qui suit, sur plusieurs décennies, le destin de familles juives polonaises, de l’après-guerre jusqu’à nos jours.
Le récit embrasse cinq générations, traverse trois continents, et fait sentir, de l’intérieur, ce que veut dire reconstruire une vie tout en étant habité par l’Histoire, avec cette impression rare que le temps n’est pas un décor, mais une matière vivante, un souffle continu. Et je me suis surpris à penser : voilà, c’est exactement ce que je cherche, moi aussi ; raconter l’Histoire en passant par le cœur, les cuisines, les voix, les liens.
Tout commence dans une maternité de Varsovie : deux femmes s’y croisent au moment où leurs vies basculent : Nina s’apprête à mettre au monde son premier enfant, Ewa, tandis que Pola attend Adam, le petit frère de Basia. Cette scène, en apparence banale, devient le noyau d’un monde romanesque immense : de cette coïncidence naît une amitié tenace, d’abord entre deux familles, puis élargie à d’autres, une fraternité qui résiste aux années, aux kilomètres et aux secousses de la vie. Les enfants grandissent à portée de voix, et autour d’eux se forme une petite tribu tissée de solidarités et de blessures.
Quatre familles juives polonaises (au sens large) se reconnaissent et s’adoptent : Nina et son mari Marek, Pola et Andrzej, Sabine, une voisine qui élève seule sa fille Monika, et des cousins rencontrés par hasard sur une plage, Heniek et Teresa. Ensemble, ils partagent tout : les peurs, les joies, les naissances, les deuils, les moments de vache maigre. Et surtout, ils inventent une manière de tenir debout, à plusieurs, dans un pays où l’avenir se gagne souvent à la débrouille. En lisant ces premières pages, je revoyais mon propre projet : cette envie de donner la part belle aux gens, aux gestes, aux filiations, plutôt qu’aux dates froides.
L’une des grandes forces du roman, c’est sa façon de rendre l’ordinaire bouleversant. Cette petite tribu partage tout… et s’entraide quand les pénuries surviennent. Ils se retrouvent souvent, espérant des jours meilleurs, ils refont le monde autour d’une vodka ou d’une bière. L’arrivée d’un réfrigérateur, obtenu grâce à un ami, devient un événement à fêter, parce qu’il change vraiment le quotidien : ils trinqueront à ce frigo que Nina et Marek ont pu acheter via un copain, avec une bouteille de Zubrowka, cette vodka parfumée à l’herbe de bison. Nina n’aura plus à faire couler l’eau froide l’été pour garder le lait au frais dans la baignoire, ou à aller chercher son beurre congelé sur le balcon en hiver. La convivialité prend ici le goût d’une résistance : la joie n’efface pas la peur, elle lui tient tête. C’est dans ces détails que le roman m’a happé : il montre qu’un peuple se raconte aussi à travers un objet attendu, une table dressée, une routine préservée.
Car derrière ces moments de chaleur collective plane une mémoire lourde : celle de familles déjà décimées par la Shoah. La saga s’ouvre dans la Pologne du début des années 1950, avec des personnages qui aspirent à une vie plus douce, plus stable, avant d’être rattrapés par une réalité brutale : leur origine juive, même vécue sans pratique religieuse, redevient un marqueur dangereux, et l’exil s’insinue peu à peu dans leurs trajectoires. Après la mort de Staline, un apaisement semble possible, ils espèrent retrouver un peu de calme. Mais en mars 1968, le régime et le climat social se durcissent : des campagnes contre les Juifs les poussent au départ ; ils sont brimés, attaqués.
Le roman montre alors une violence particulière : celle d’être rendu indésirable dans son propre pays, non pas par un front de guerre, mais par une atmosphère qui vous désigne. Le cœur en lambeaux, trois des familles décident de s’expatrier, là où on veut bien les accueillir : l’une part en Israël, une autre au Canada, la dernière en Amérique. L’exil n’a rien d’une aventure : on les suit dans leur installation difficile ; l’adaptation est compliquée, autant pour les enfants que pour les parents, chassés de leur pays natal. Et là, je me suis souvenu de ce que j’avais écrit à Samuel : que je veux parler d’une histoire laissée dans l’ombre, mais sans la réduire au malheur ; en laissant affleurer, malgré tout, la dignité et la beauté des vivants.
Et pourtant, malgré l’éloignement, quelque chose résiste. Ils ne vont pas se perdre de vue : ils échangeront des lettres, mais avec les mois, les liens se distendent un peu, sans jamais se rompre. Ces lettres, dans le roman, m’ont fait l’effet d’une respiration : comme si l’encre remplaçait les bras, comme si l’amitié devenait une adresse. C’est là que le livre devient particulièrement actuel : il raconte l’immigration sans slogan, avec ses espoirs, ses combats, ses malentendus, ses fatigues.
Il rappelle que partir ne suffit pas : il faut encore apprendre à vivre ailleurs, à décoder des codes, à porter un autre nom, parfois une autre langue, tout en restant soi. Les personnages passent leur vie à se réinventer : changer de pays, d’adresse, de langue, et garder, malgré tout, une fidélité intérieure. Une question affleure, insistante : avec qui partage-t-on ses souvenirs quand on a changé de pays, de nom, de culture ? Cette interrogation résonne fortement au Québec, où les débats sur l’accueil et les seuils d’immigration reviennent souvent, et où le roman évoque le parcours d’une intégration réussie. C’est exactement le type de question qui relance mon propre chantier : qui nous écoute quand notre mémoire n’a plus de place officielle ?
Ce qui m’a le plus marquée dans cette lecture, c’est ce sentiment d’accompagner ces personnages sur la durée. On les voit grandir, vieillir, se transformer : les enfants deviennent parents à leur tour, les parents deviennent grands-parents, et les petits-enfants prennent le relais. Suivre l’évolution de ce petit monde, ses bonheurs, ses deuils, ses métamorphoses, m’a émue et captivée jusqu’au bout. Et ce qui fait tenir tout cela, malgré les épreuves et les coups du sort, c’est finalement assez simple : il y a toujours, à un moment ou à un autre, quelqu’un pour renouer les fils, pour rapprocher les cœurs, pour resserrer les liens entre ces quatre familles.
Le roman inscrit ses personnages dans une chronologie historique ample : on reconnaît le contexte, depuis l’attaque de la Hongrie en 1954 jusqu’aux attentats du 11 septembre, en passant par la Pologne (le traitement des Juifs en 1968, la visite du pape en 1979). Mais il n’oublie jamais la « petite histoire » : une manifestation pour la langue, ou un concert à Montréal, ces moments modestes où l’existence se construit autant que dans les grands livres d’Histoire. Et moi, lecteur, j’avais l’impression de tenir un fil : celui qui relie les dates aux visages, et les visages aux gestes.
Un autre choix narratif ressort : en changeant de style au milieu du livre, avec les correspondances entre ceux qui s’éloignent peu à peu, l’autrice redonne un souffle unique au récit. Les lettres deviennent un pont, mais un pont fragile : elles maintiennent la présence tout en révélant l’écart. Les années passent, les liens s’effritent parfois, sans disparaître. Cette variation de forme m’a rappelé que, pour écrire une histoire longue, il faut accepter de changer d’outil, de rythme, de respiration, comme on change de route quand le paysage l’exige.
Au final, Ça finit quand, toujours ? d’Agnès Gruda apparaît comme une formidable histoire qui embrasse cinq générations sur trois continents : le déracinement, l’exil, beaucoup d’émotions. Une saga familiale de migrations et d’enracinement. Une belle écriture, des personnages attachants, une lecture touchante. Et surtout, cette idée tenace, presque consolante : malgré les distances, rien ne les séparera vraiment. Et je sais déjà une chose : ce roman ne se contente pas d’être lu, il donne envie de répondre, de créer à son tour.
J’aime la plume d’Agnès Gruda parce qu’elle sait émouvoir sans tirer sur la corde, faire entrer l’Histoire sans piétiner les vies, et confier aux détails, une table, une voix, une lettre, le soin de dire l’essentiel. Rien n’y pèse, rien n’y pose : c’est ample, juste, profondément humain. Et quand j’ai refermé le livre, j’ai compris ce qu’il venait de déplacer en moi. J’ai rouvert mon téléphone, j’ai pensé à mon ami Samuel, et j’ai senti mon vieux projet respirer de nouveau. Pas pour écrire comme un historien, mais pour offrir un foyer aux mémoires sans adresse, et rendre à cette histoire, enfin, sa lumière.
______________________________
Ça finit quand, toujours ? d’Agnès Gruda / Éditions du Boréal / Parution : 18 mars 2025 / 480 pages / ISBN-13 : 9782764628751 / Code barre : 9782764628751.
En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien
Subscribe to get the latest posts sent to your email.